La boue rouge ( suite)
Sources et indications
bibliographiques
Au cœur du cyclone
Le 3 janvier 1915, au matin, le 15-2 reçut l'ordre d'enlever Steinbach et l'ouvrage en V tout en
essayant d'avancer sur le plateau d'Ufflholtz. Le
plan d'opération était le suivant : le bataillon
Castella, dont la 3e Cie. était placée en réserve,
prendrait l'ouvrage en V et le terrain situé entre
celui-ci et l'église, appuyé par la batterie
Bousquet ; l'attaque serait combinée sur la droite par quatre sections du 213e R.I. dont la section
de mitrailleuses du lieutenant Martin. Pendant ce
temps, les 11e et 12e Cies. et la section de
mitrailleuses du IIIe bataillon (commandant
Contet), soutenues par une batterie de 75, s'empareraient du centre du village et du cimetière ;
les deux autres compagnies du IIIe bataillon
déborderaient par le nord pour occuper, au-delà
du ruisseau, les tranchées allemandes montant au
plateau d'Ufflholtz sur lequel progresserait le 15e
B.C.P chargé de parer à toute contre-attaque
venant du nord. Les 7e et 8e Cies. resteraient à la
disposition du commandant Jacquemot.
Quatre compagnies du 213e R.I, sous les ordres du commandant Debain,
partiraient à l'assaut de la cote 425 : les 17e (Lecuyer) 19e(Rochut) et
22e (Labbe) compagnies prendraient puis retourneraient la tranchée
allemande tandis que la 21e Cie, d'abord en réserve, les dépasserait
puis couvrirait leurs travaux d'organisation. Les 2e (de la Tour) et 3e
(Didio) Cies. du 13e B.C.A. appuieraient le mouvement sur 425.
Conscient de l'inefficacité des pièces de 65 à désorganiser les lignes
adverses, l'Etat-major, mobilisa l'artillerie lourde de la division ; à
9 heures, la préparation d'artillerie débuta par les tirs d'une batterie
de 155 L. sur 425, suivis des canons de 75 et 65 ; le marmitage devait
durer plus de trois heures.
A 13 heures, les sifflets des officiers résonnèrent, déclenchant
l'attaque générale ; les fantassins, précédés de sapeurs équipés de
cisailles, se mirent à courir, autant pour chasser l'ennemi que leur
propre peur. Des maisons que l'on croyait vides se révélèrent occupées ;
les sapeurs de la 1° Cie., pris en enfilade, furent décimés ; à 13h30,
deux batteries de 75 bombardèrent l'Institut Saint-André pour
appuyer l'attaque de diversion du groupe cycliste de la 10e D.C. La 2e
Cie. du 15-2 avança camouflée par une haie et s'empara d'une tranchée ;
la 1er Cie, contrainte de se faufiler par un chemin creux, se fraya un
passage entre les barbelés et déboucha sur un poste d'une douzaine
d'hommes de l'I.R.161 qui se rendit. Les occupants de l'ouvrage en V,
menacés d'enveloppement, se replièrent vers le centre du village,
poursuivis par une section qui arriva jusqu'à l'église, devant laquelle
le sergent Fallouey fut tué à bout portant. Des deux côtés, les
artilleurs évitaient le cœur du village où la situation était incertaine
; une batterie de 65 fut avancée vers le village ; les tirs de barrage
des canons de 75 empêchaient l'arrivée des renforts allemands depuis les
lisières ouest de Cernay ; des éléments des 1er , 2e et 4e Cies ayant
opéré une liaison, les officiers décidèrent de poursuivre l'élan pour
déborder tout le village par le sud ; le lieutenant Eugène Bauer fut
mortellement atteint en arrivant à la dernière maison, à l'extrémité
sud-est de Steinbach ; les 1er et 2e Cies., rassemblées sous le
commandant
des lieutenants Jenoudet et Boucher, réussirent la manœuvre et les
Allemands battirent en retraite.
De leur côté, les compagnies du 213e R.I, traversant les abattis et les
réseaux de barbelés, s'étaient emparées de 425, faisant une soixantaine
de prisonniers. Apprenant la nouvelle, le commandant Castella donna
l'ordre de conquérir l'est du village et demanda à la 12e Cie.
(capitaine Toussaint) de fouiller le centre du village et de progresser
par la rue principale pour entrer en liaison avec la 3e Cie. (capitaine
Bejanin) ; cette dernière, jusqu'alors en réserve, avait traversé le
village d'ouest en est et pris position, vers 20hl5, le long des murs de
l'usine et des jardins Rollin ; la 12e Cie. exécuta son mouvement avec
peine, ce qui permit à plusieurs groupes d'Allemands de se replier sans
dommages par les tranchées montant sur le plateau d'Uffholtz ; les 2e et
4e Cies. redressèrent leur front face à Cernay, entre Steinbach et les
pentes nord de 425 ; la section de droite de la 12e Cie. fut sévèrement
accrochée autour du cimetière. Sur ordre direct du commandant du 152e
R.I, le capitaine Toussaint déborda ce nœud de résistance avec le renfort
d'une section et demie et opéra une jonction vers l'église avec la 1er
Cie.. Mais, ce ne fut que vers 22 heures, sur la demande, puis l'ordre
formel du commandant Castella, que la liaison
avec la 3e Cie. fut établie ; sur la gauche, la 11e Cie. avait suivi le
mouvement. Vers minuit, la lisière nord-est de Steinbach était aux mains
des pantalons rouges.
Les rues de Steinbach étaient jonchées de cadavres de soldats, d'animaux
et de quelques civils, de débris et de matériel ; les blessés,
agonisants, étaient soignés à la hâte dans l'attente d'une évacuation ;
les rescapés de cette tourmente, harassés, éclairés par les incendies,
fouillaient les décombres à la recherche de quelques victuailles:
volailles, miel, eau-de-vie...; le village, balafre et hurlant, semblait
sortir d'un tableau cauchemardesque de Jérôme Bosch.
Les Allemands ne pouvaient en rester là ! Ils avaient été ébranlés, mais
disposaient toujours de moyens considérables et rapidement mobilisables.
Dès 21 heures, les sifflements des 105 et 150 avaient commencé à
résonner ; les batteries, installées de Berrwiller à la forêt du
Nonenbruch d'où un Drachen faisait quelques apparitions furtives,
préparaient une contre-attaque massive. Vers 1 heur du matin, l'I.R 25
et quatre compagnies du I.R. 161 ( les 5,8,9 et 11) s'élancèrent;
les fifres et tambours résonnaient dans la nuit et la vague feldgrau
déferla sur la cote 425, attaquée de front et sur les flancs ; les
fractions de protection, en avant des soldats qui travaillaient à
fortifier la ligne, reculèrent en tirant; les défenseurs, submergés,
pris dans la mêlée, se replièrent sur les tranchées de départ ; un
peloton de la 19e Cie. du 213e R.I. sous les ordres du lieutenant Rochut
résista en vain avant de reculer pour éviter l'encerclement.
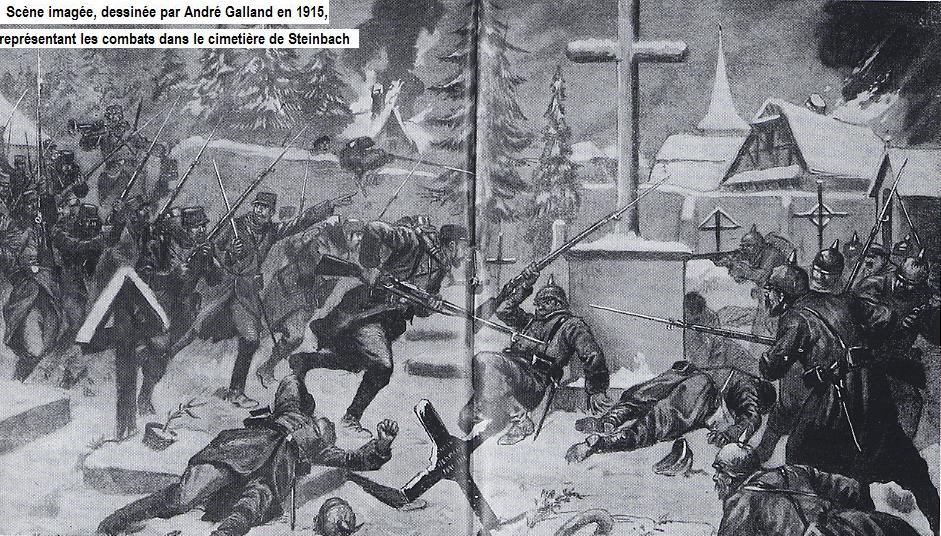 A la lisière est de Steinbach, l'attaque fut endiguée par la 3e Cie., mais un groupe descendu par
le plateau d'UffhoItz perça les lignes et une vingtaine d'hommes, emmenés par le Leutnant
Moskopp (8/I.R. 25) atteignirent l'église si bien
que, l'obscurité aidant, la situation à l'intérieur
du village devint aussi critique que confuse ; des
agents de liaison du 15-2 furent capturés et
enfermés dans l'église ; les adversaires, vociférant, tiraient à bout portant. Par manque de
fusées éclairantes, les Français estimèrent le
nombre des assaillants à environ soixante-dix.
L'Etat-major songea un moment à faire évacuer
le village puis décida d'engager la 8 Cie du 15-2 (capitaine de Roffignac), placée en réserve.
Arrêtés un instant, les fantassins nettoyèrent le
secteur de l'église et firent une quarantaine de
prisonniers, dont deux officiers réfugiés dans l'église. Vers 3 heures,
l'ouvrage en V et le village étaient reconquis. Côté allemand, après le
repli, un bon nombre de combattants manquait à
l'appel dont les Leutnants Bappert et Kamp,
commandants des 9e et 11e compagnies.
A la lisière est de Steinbach, l'attaque fut endiguée par la 3e Cie., mais un groupe descendu par
le plateau d'UffhoItz perça les lignes et une vingtaine d'hommes, emmenés par le Leutnant
Moskopp (8/I.R. 25) atteignirent l'église si bien
que, l'obscurité aidant, la situation à l'intérieur
du village devint aussi critique que confuse ; des
agents de liaison du 15-2 furent capturés et
enfermés dans l'église ; les adversaires, vociférant, tiraient à bout portant. Par manque de
fusées éclairantes, les Français estimèrent le
nombre des assaillants à environ soixante-dix.
L'Etat-major songea un moment à faire évacuer
le village puis décida d'engager la 8 Cie du 15-2 (capitaine de Roffignac), placée en réserve.
Arrêtés un instant, les fantassins nettoyèrent le
secteur de l'église et firent une quarantaine de
prisonniers, dont deux officiers réfugiés dans l'église. Vers 3 heures,
l'ouvrage en V et le village étaient reconquis. Côté allemand, après le
repli, un bon nombre de combattants manquait à
l'appel dont les Leutnants Bappert et Kamp,
commandants des 9e et 11e compagnies.
Au nord, dans le ravin d'UffhoItz, les 9e et 10e
Cies. du IIIe bataillon du 15-2 avaient été clouées
dans leurs tranchées de départ par le feu de
mitrailleuses sous boucliers et par un bombardement de gros calibres ;
les tirs de crapouillots,
durant un quart d'heure, n'avaient pas empêché
les renforts allemands d'accéder aux tranchées
de tirs. Vers 4 heures passées, le commandant
Contet, depuis l'observatoire du Schletzenburg,
demanda le raccordement des tranchées du ravin
à celles du village ; De Liocourt, monté convaincre Contet de stopper l'attaque, décrivit le brasier :
"Spéctacle complet de la bataille en ce point sous
un marmitage intense. Vue sur Steinbach à moitié démoli et en feu : cris de nos assauts, lueurs
rutilantes des villages qui brûlent à perte de vue dans la plaine.
Derrière nous des tombes préparées avec croix et couronnes de feuillages ; les
blessés qui passent sur des civières et les morts
que l'on aligne, de très jeunes prisonniers qui
montent. (...) Dans le village qui flambe, fusillades et cris toute la nuit - France-Kamarade ".
Le 4 janvier, au matin, sous une pluie d'obus de
150, les hommes encore valides fouillèrent
minutieusement les ruines, débusquant des
Allemands pris au piège ; dans les caves transformées en abris ; armes,
munitions et effets personnels étaient quelques fois restés en place. Le
village englouti gémissait : craquements, plaintes, grondements sourds; des charpentes brûlées,
des pans de mur calcinés s'effondraient ; le feu
serpentait au milieu des débris, des corps, des
carcasses d'animaux qui se consumaient ; l'odeur était pestilentielle ; partout, des fumerolles
montaient vers le ciel. Un chien errait parmi les
cadavres tel un charognard ; un bœuf encore
vivant demeurait immobile, perdu. Certains soldats étaient assis, hagards, submergés par cette
vision d'apocalypse, ce carnage auquel ils
avaient pris part ; curieusement, le clapotis de la
fontaine demeurait immuable, comme si le
temps passé cherchait à se prolonger, imperceptiblement.
Maurice Ravel rassura son père :"Grâce à Dieu
je suis encore sain et sauf, en dépit des balles et
des obus ! Steinbach est virtuellement pris ; mais pour ce résultat il a
fallu détruire le village, maison par maison, à coup d'obus. Un certain
nombre de maisons sont encore occupées par les
Allemands qui s'y barricadent et s'y défendent
avec une énergie désespérée. Beaucoup se sont
rendus car ils étaient las de se battre et abrutis
par le bombardement. Les rues et les abords du
village sont semés de cadavres. C'est horrible à
voir. Les corps resteront longtemps ainsi sans
sépulture. Les compagnies qui occupent la partie
conquise campent parmi les ruines et au milieu
des cadavres en décomposition ". Mais la lisière
nord du village demeurait sous le feu de la tranchée avancée du plateau d'UffhoItz. La 7e Cie.
fût chargée, en partant de l'usine Rollin, de grimper à travers les vignes pour occuper l'extrémité
gauche de cette tranchée et la prendre à revers ;
préparée par une batterie de 65 et soutenue par la
section de mitrailleuses du IIIe bataillon, l'attaque surprit les Allemands ; sur le plateau, des
fractions des 9, 10 et 11e Cies. profitèrent du
mouvement pour prendre pied dans la tranchée et
s'y maintenir, faisant des prisonniers, récupérant
du matériel, des munitions et une mitrailleuse.
Le capitaine de Liocourt fut au cœur de l'action :
"J'entraîne la 7e"' section avec deux sections de
la 9e compagnie. On prend toute la tranchée
boche. M... est tué et la deuxième section presque
entièrement détruite. Elle gît par-ci par-là dans
les échalas. Je reforme les unités et répartis le
commandement. Les boches tirent tout le temps
pour nous empêcher de renverser la tranchée.
J'entre dans leurs abris. Une bougie brûle encore ; cela sent encore leur odeur et celle de leur
tabac. Des armes, des casques, partout. Nous
sommes surpris de voir comme c'est bien installé. C'est recouvert de tôles ondulées très fortes.
J'essaie de faire mettre du fil de fer, mais impossible cela tire de trop. La pluie arrive ; comme le
principal est fait j'en laisse quelques-uns se mettre à l'abri. Tout à coup les hommes en faction
lancent le cri de « Aux armes ». On court au
parapet, quand les premiers sont à dix mètres. Je
dirige là-dessus un feu d'enfer, par salves.
L'attaque tourbillonne et s'effondre. Pour nous
c'est gagné, mais on tire encore sur ce que l'on
voit remuer et assez longtemps encore, car les
arbres semblent être des hommes".
Au sud, les canons de 155 L. tirèrent sur la cote
425, mais l'organisation défensive de Steinbach,
sous le pilonnage intensif de l'artillerie allemande (des obus 77, 105, 130, 150 et 210) accaparait
les troupes disponibles pour une éventuelle contre-attaque. Ainsi, l'I.R.25 en profita pour s'y établir solidement, ce qui obligea les nouveaux
occupants du village à retourner certaines tranchées vers le sud. Les gouttes de pluie rayaient
un paysage de désolation. Le chassé croisé des
brancardiers était constant ; le G.B.D.66 effectua
235 évacuations ce jour là ; dans les hôpitaux de
Thann et de Moosch, engorgés, les lits manquaient et les chirurgiens opéraient sans arrêts ;
les blessés légers retournaient au front ; ceux qui
pouvaient être transportés rejoignaient l'hôpital
d'origine des étapes (H.O.E.) de Bussang,
embarqués par la section sanitaire automobile N°17 ; pour certains, un nouveau combat commençait
; pour beaucoup d'autres, les cas désespérés, la mort n'étaient que retardée.
L'Etat-major de l'Armee-Abteilung Gaede réagit
rapidement en remplaçant la Brigade V Strantz
par la Brigade Dallmer. Les Français avaient pris Steinbach, mais ils se
retrouvaient bloqués, coincés dans un vallon encaissé et difficile à
ravitailler ; les positions défensives allemandes
autour de Cernay demeuraient solides et une
offensive sur la droite, par les hauts, là où la 66e D.I. ne disposait
que de postes épars, ne manquerait de rendre sa situation intenable ; une première tentative eut lieu le 4 janvier : à 7 heures,
la 8e Cie. du L.I.R.123 (Leutnant Wagner) et 50
hommes du IIe bataillon de Landsturm de
Heidelberg encerclèrent le sommet de l'Hartmannswillerkopf, tenue par
une demi-section du 28e B.C.A.et dont l'imposante silhouette
coupait l'horizon ; l'occupation des massifs au
nord de Cernay devenait essentielle aux yeux des
officiers du quartier général, en particulier pour
le nouveau chef d'état-major, Bronsart von
Schellendorf qui, arrivé le 5, décida de poursuivre les opérations sur l'Hartmann et le Sudel.
L'Etat-major français, moins prompt, ne se rendit
compte qu'à posteriori de l'intérêt d'un mouvement par le nord et le nord-ouest permettant de
profiter de l'absence de front continu pour se
rabattre ensuite par le sud-est dans la plaine.
L'engrenage qui allait faire du promontoire
rocheux de l'Hartmannswillerkopf un champ de
bataille légendaire était en marche ; les
Allemands avaient tiré les premiers.
Le 5 janvier, la 151e brigade (297e, 357e et 359e
R.I.) du colonel Adolphe de Susbielle, détachée
de la 71e D.I. à la 66e D.I., vint épauler une 115e
brigade très affaiblie. La terre continuait à trembler et un déluge d'acier s'abattait sur le petit
village et ses alentours, pris dans une atmosphère d'apocalypse. "Dès qu'il fait jour, commence
sur nous un bombardement effrayant. Il y a de
tous les calibres, mais surtout du gros. Notre
artillerie répond, et toute la journée, cela n 'arrête pas. Les grosses casseroles passent dans les
deux sens et éclatent. Il pleut, nous sommes
envahis par l'eau par en dessous et peu à peu, par le contact avec les
parapets, nous nous couvrons d'une carapace de boue grasse jusqu'à la
tête. L'artillerie redouble spécialement vers 12
heures. À un moment, il y en a un qui crie : "c 'est
comme au Spitzemberg". Je le fais taire, car ce
cri résonne comme un glas. Des obus éclatent
devant, derrière, à droite, à gauche, partout.
J'entends un blessé qui pleure comme un petit
chat à 2 mètres de moi ; je lui demande ce qu'il
a ; on me dit qu'il a une balle dans la tête. C'est
vers Cernay que sont les obusiers qui nous tirent dessus. On entend très nettement le départ des
coups, et on suit leur arrivée. On m'annonce que
le capitaine Jacquot vient d'être renversé par
une marmite. On a l'impression que personne
n 'en sortira. Il y en a un qui dit que cela doit être la fin du monde.
Au milieu de tout cela, les guetteurs surveillent, stoïques. Cela continue ainsi
toute l'après-midi, sans interruption. Tout le
village de Steinbach flambe et les obus de 305 y
tombent constamment. Tous les prisonniers sont
unanimes à dire qu'ils ont de l'artillerie autrichienne (probablement des obusiers Skoda de
305, Mle 1911). Quand le soir arrive nous sommes hébétés. Nous sommes dans la boue jusqu'aux
genoux. Nous sommes trempés et naturellement nous n 'avons rien mangé.
D'ailleurs, nous n 'avons pas le cœur à manger" (capitaine de
Liocourt). Le sergent Jules Gavand du 359e R.I,
participait au ravitaillement difficile et périlleux
des avant-postes ; il fut subjugué par le brasier
des combats : "À la nuit tombante, je partais de
Thann avec le courrier, étant vaguemestre, les
ordres et pièces à signer, étant fourrier, et je m 'acheminais avec
quatre mulets porteurs de ravitaillement et de boisson chaude, vers la cote 425
où était ma compagnie. Le chemin pour y aller, surtout pendant la nuit,
était épouvantable, rempli de cailloux et de boue liquide. Les mulets
avaient le pied sûr, et le mieux était d'en tenir un
par la queue, ce qui facilitait la marche. Un soir
qu'il faisait nuit noire, en redescendant de la
cote 425 et une fois sur la grande route, j'avais
derrière moi Cernay qui brûlait, incendie
immense. Les projecteurs boches fonctionnaient
dans toutes les directions. Entre moi et Cernay,
l'église de Vieux-Thann, avec un bout de toiture
sans tuiles, le reste étant écroulé, se profilait
dans les flammes de Cernay brûlant. Avec cela
un crépitement incroyable de coups de fusil dans
le lointain, des coups de canons français aux
abords de ma route, je ne les voyais point, mais
les entendais. Plusieurs civières me croisent,
portant des blessés ; et la pluie tombe, une pluie
torrentielle. Je ne pensais plus à la guerre ; il me
semblait que j'étais à l'Opéra, avec des décors
magnifiques représentant un coin de l'enfer. Je
me suis arrêté et j'ai joui pendant quelques
minutes de ce spectacle qui finit par m'effrayer
parce qu'il était trop réel ".
Dans le cimetière de Steinbach, devenu bien
exigu, et sur les pentes du Silberthal, les tombes
s'étaient multipliées ; le 15-2 avait perdu plus de 700 hommes, morts,
blessés, disparus ou prisonniers ; le 213e R.I. laissait 420 hommes sur
le terrain dont le lieutenant-colonel Frantz, éphémère
gouverneur de Thann. Au 161e Infanterie
Régiment, 660 hommes étaient hors de combat. Après son séjour alsacien,
les effectifs du régiment von Lützow tombèrent à près de 600 hommes (au 26 mars 1915). Les survivants, accablés
par les intempéries et les alertes, mirent leurs
dernières forces à l'organisation des positions.
L'enfer de Steinbach, les combats de rue, la pluie
et les flammes, la boue de 425, rouge, poisseuse,
allaient rester gravés à jamais dans leurs mémoires.
La prise de Steinbach défraya la chronique ; la
presse française et les communiqués officiels
firent de ce fait d'armes un symbole du retour de
l'Alsace à la mère patrie. Mais, cette conquête
destructrice et coûteuse en vies ne fit reculer les
Allemands que de quelques centaines de mètres.
Bref, une victoire à la Pyrrhus !
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, un tentative sur le
village, un coup de sonde, laissa 60 cadavres
devant les tranchées françaises. Le jour venu, la
151e Brigade lança une attaque en tenaille. A
droite, le 359e R.I. tenta de s'emparer de
Sandozwiller, mais le feu nourri des soldats allemands, retranchés dans l'usine textile et sa cité
ouvrière, maintint le régiment dans ses lignes ;
plus d'une vingtaine d'hommes furent fauchés
en sortant des tranchées. A gauche, le 297e R.I., avec deux compagnies
en pointe, s'élança à l'assaut des tranchées de 425. Le régiment fut
décimé par les mitrailleuses et les tirs croisés de l'artillerie lourde allemande en position à Wattwiller
et Cernay. Deux compagnies du 13e B.C.A., en
réserve, tentèrent sans succès de colmater les
brèches. Le 297e R.I. perdit 436 hommes dans l'opération dont son chef
de corps, le lieutenant-colonel Bonnelet. Parmi les disparus, se trouvait
le caporal Louis Demeure-Lattaz qui, le 27
décembre 1914, avait adressé à sa femme enceinte une lettre d'espérance, la dernière : "Ma chère
Rose, (...) Jusqu'à présent, nous avons toujours
couché à l'abri. Nous avons trouvé des pays de
l'Alsace, qui ont été repris par nous et où l'on est
bien reçu. Mais c'est difficile de se faire comprendre, car il y a très
peu de gens qui connaissent le français. Les villages que nous avons vus
sont très propres ; c'est dommage que l'on
entende le canon toute la journée et même la
nuit. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir;
espérons que cela ne sera pas trop dur et que
nous aurons le bonheur de nous revoir tous un
beau jour. La nuit, quand je pourrais dormir, je
suis à chaque instant réveillé par des cauchemars terribles. Je vous revois souvent dans mes
rêves et il me semble que je tiens tous les trésors
de la terre, mais au réveil, quelle désillusion.
J'espère que vous avez bien passé les fêtes de
Noël. Nous avons eu le plaisir d'aller à la messe
le jour de Noël. Nous n 'avons pas pu, à mon
grand regret et de beaucoup de mes camarades,
assister à la messe de minuit. Il était interdit de
sortir des cantonnements. Le jour, la messe a été
dite par l'aumônier militaire du régiment.
L'église, quoique bien grande, était remplie de
soldats. J'espère que ma lettre vous trouvera en
très bonne santé. Je renouvelle tous mes vœux
de bonheur que je puisse vous souhaiter, de bon
courage et d'espoir et aussi ma chère Rose, une
heureuse délivrance. Je vous embrasse dans un
baiser plein d'espoir et d'amour". Les artilleurs
allemands marmitèrent tout le secteur jusqu'à
Thann où l'hôpital, touché de plein fouet, fut
transféré sur Bitschwiller.
Sur la cote 425, le no man's land était jonché de cadavres, englués dans
une boue rouge et enterrés par les bombardements ; les corps du 297e
recouvraient ceux du 213e. Les assauts frénétiques et meurtriers n'avaient fait que rapprocher
les premières lignes et jusqu'au printemps, des cadavres gelés restèrent
alignés devant les parapets.
Un rapport du service de santé précisa les pertes,à l'exception des disparus et prisonniers. Ainsi,
pour la période du 25 décembre 1914 au 10 janvier 1915 on compta :168 tués et 287 blessés
pour les 152e R.I. ; 105 et 208 pour le 213e R.I. ;
73 et 202 pour le 359e R.I. ; 32 et 59 pour le 13e
B.C.A. ; 20 et 62 pour le 15e B.C.P. ; 8 et 20 pour
le 28e B.C.A. ; 5 et 32 pour le 68e B.C.A. ; 4 et 6
pour le 56e R.A.. Plusieurs raisons expliquaient
l'importance des pertes, eu égard à l'étroitesse du front : les vignes
et les prés entourant le village n'offraient que peu de protection aux
combattants ; ainsi, sortant des forêts, à découverts, les
fantassins avaient subi simultanément les tirs de
mitrailleuses partant du village et le flanquement
depuis le plateau d'Uffholtz et la cote 425. La
décision tardive de l'attaque du 25, avait donné
aux Allemands du temps pour renforcer leurs
défenses. En outre, l'artillerie française avait
montré ses limites ; des canons de montagne de
65 avaient pu être rapprochés de la zone des
combats, mais les batteries de campagne, installées vers Thann et Leimbach, trop lointaines, ne
pouvaient rivaliser avec l'artillerie lourde allemande, proche des lignes, aisément déployable
dans la plaine et battant l'ensemble du front. Les difficultés à
acheminer hommes et matériel, l'acharnement de l'état-major, le prestige et les
défaites passées, les ordres péremptoires et les
conditions climatiques furent autant d'éléments
qui contribuèrent à l'hécatombe.
L'échec du 7 janvier 1915, l'épuisement physique et moral des troupes, amenèrent le général
Guerrier, le 9 janvier, à suspendre les opérations
dans le secteur Steinbach-425. La bataille de
Steinbach, engagée le 13 décembre, marquait de
par sa durée un basculement : celui d'une guerre
de mouvement à l'enlisement d'une guerre de
position, celui des batailles courtes, de quelques
heures, quelques jours, aux batailles longues,
interminables, alternant phases de combats et
d'organisation sur plusieurs mois.
Au 152°R.I., les effectifs furent progressivement
reconstitués ; un détachement de renfort de 250
hommes arriva le 11 janvier, un autre de 300
hommes deux jours après, puis finalement 72
soldats le 22. Les lignes étaient organisées en
trois secteurs, chacun confié à un bataillon avec
deux compagnies en première ligne, une compagnie en réserve de bataillon et une compagnie au
Schletzenburg en réserve générale. Les premières lignes étaient relevées tous les deux jours,
puis sous quatre jours.
Le secteur sud était situé entre 425 et le village,
jusqu'à l'église. Le secteur centre comprenait le
village et un bout de la tranchée allemande
conquise, accessible par un boyau aménagé à travers les vignes, jusqu'au premier chemin de terre
qui la traversait. Enfin, le secteur nord allait de
ce chemin au ravin d'UffhoItz, tenu par une section du 15e B.C.P. Les travaux de fortification se
poursuivaient entre les bombardements. Les objets précieux restés dans
l'église furent ramassés et envoyés à Willer. Le 16 janvier, en trois
heures, 250 obus de gros calibre tombèrent sur
Steinbach. Le 297e R.I. prit position face à la
cote 425 ce qui permit au 15-2 de réduire son
déploiement et d'envoyer davantage de troupes
au repos, à Bitschwiller et au Thomannsplatz.
Par ordre général n°4 du 25 janvier 1915
(J.O.R.F. du 24 février 1915), le 152e R.I. fut cité
à l'ordre de l'Armée, en ces termes : "(...) a,
sous les ordres du chef de bataillon Jacquemot
fait preuve d'une vaillance et d'une endurance
au-dessus de tout éloge en conquérant un village,
après huit jours de lutte héroïque, de jour comme
de nuit, s'emparant une par une des maisons fortifiées, répétant les assauts au milieu des incendies, se maintenant sous un feu des plus violents
dans les tranchées remplies d'eau gelée, infligeant à l'ennemi de lourdes pertes et lui en enlevant une mitrailleuse et de nombreux
prisonniers ". Quelques jours plus tard Jacquemot fut
promu lieutenant-colonel.
Le 5e B.C.R, en position au Südel, retrouva le
secteur de Steinbach. Robert Pelissier avait suivi
la bataille décisive depuis le col : "Alors que
nous étions là-haut, Steinbach fut reprise,
comme vous avez dû le lire dans les journaux. Il
fallut la prendre maison par maison ; et dire que
nous l'avions tenue quelques semaines plus tôt
sans pertes sérieuses !
Le 14 janvier, nous descendîmes de notre col
pour aller au repos et nous laver et le 18 janvier,
nous reçûmes l'ordre d'occuper les nouvelles
tranchées creusées face à Steinbach reconquise.
Nous gravîmes donc la montagne pour la dévaler sur le versant opposé, parcourant ainsi un
territoire qui ne nous était que trop familier.
Une fois encore, ce fut le bon filon. Il faisait
froid et nous ne pouvions allumer aucun feu de
peur d'être repérés par l'artillerie. Nos cuistots
durent installer leurs cuisines à plus d'un mile
en retrait de la deuxième ligne, et même là, ils
furent bombardés. Deux d'entre eux furent tués
alors qu'ils tentaient de nous apporter notre
dîner. Je ne restai là que neuf jours, puisque je
fus blessé comme je vous l'ai dit plus haut, mais
mes malheureux compagnons y restèrent trois
semaines, et furent bombardés presque quotidiennement. Ils repoussèrent
trois attaques, perdirent leurs mitrailleuses par deux fois, et les
reprirent lors de contre-attaques de nuit, ramenant à chaque fois un nombre respectable de
prisonniers. L'un dans l'autre, c'est surtout du
froid que nous eûmes à souffrir. Des centaines
de nos hommes durent être évacués pour cause
d'orteils gelés, de pieds gelés ou de bronchite. Blessé, Pelissier fut évacué sur un hôpital
militaire où il resta jusqu'au mois de mai.
Entre le 15 et le 17 mars, le 357e R.I. releva le
152e R.I, engagé depuis bientôt trois mois dans
"l'enfer de Steinbach". Le projecteur se déplaçait, mais la cote 425, tout comme le plateau
d'Uffholtz, restaient des secteurs sensibles soumis aux fusillades, aux engins de tranchées, aux
coups de main, aux accrochages entre patrouilles
et sentinelles. Les futurs combattants de
l'Hartmann y trouvèrent une initiation ou un
répit relatif.
Le 16 avril 1915, le 334e R.I., et le bataillon
Dreyfus du 57e R.I.T. succédèrent pour cinq mois
au 357e. A droite, le bataillon Dreyfus couvrait
Steinbach, des pentes nord de la cote 425 au chemin Schletzenburg-UffhoItz. Au centre, le VIe
bataillon (Moréteaux) du 334e tenait la croupe
de la chapelle Saint-Antoine jusqu'au
Molkenrainweg. À gauche, le bataillon
Belhumeur gardait le saillant du plateau
d'UffhoItz. Les tranchées de la cote 425 étaient
occupées par le 229e R.I.. Le 10 mai, le bataillon
Moréteaux prit position à gauche du bataillon
Belhumeur jusqu'à la rive droite du Sihl, adossé
à la garnison de l'Hartmann alors constituée par
le 7e B.C.A., les 152e et 244e R.I. Du
Molkenrainweg au Sihl, le secteur prit le nom de
Colardelle. À droite, le secteur Simon s'étendait
de Steinbach à la route d'Aspach et comprenait
trois sous-secteurs : l'Alsacienne (de Steinbach à
la cote 425), Bonnelet (de 425 à la Thûr) et
Sairon (de la Thùr à la route d'Aspach). Le 26
mai, le 64e B.C.A. vint occuper le sous-secteur
de l'Alsacienne où il demeura jusqu'en juillet
1916.
Dans les sous-bois, les bivouacs s'étaient transformés en camps : Chanove,
Belgique, Les cuistots, Pervenche, Alsacienne entre Vieux-Thann et
Steinbach ; Morvan sur les pentes de
l'AmseIkopf, Roucy dans une carrière du
Silberthal. Les "grottes" du vallon, notamment
celles du Donnerloch, constituaient des abris
sûrs lors des bombardements ; le carreau de la
mine Kaiserstolhe fut aménagé et jusqu'au fin
fond de l'Ertzenbach, la foret était habitée ; barbelés, blockhaus,
abris-cavernes, tranchées profondes, boyaux onduleux se multipliaient,
lacérant le sol ; le mobilier et les objets ramassés
dans les ruines de Steinbach ou récupérés dans
les villages agrémentaient la vie souterraine. Certaines positions
firent l'objet de soins particuliers, tel le "Reposoire", édifié par le 229e R.I.
à 425 ou l'un des blockhaus de la première ligne
du plateau d'UffhoItz, construit par le 334e R.I.
et cité en exemple par le commandement du
génie de la VIIe Armée.
Avec l'arrivée des beaux jours, au printemps
1915, les abatis et branchages du no man s land
prirent feu, d'abord par accident puis par le tir de
fusées incendiaires. Sur le plateau d'Uffholtz, les
silhouettes noires des arbres calcinés ressemblaient à une armée de spectres. Aux assauts
massifs succédait une guerre de harcèlement.
Le 16 juin 1915, un coup de main fut tenté contre les organisations allemandes dites du "saillant
de 425" par des éléments du 152e R.I., du 64e
B.C.A et de l'escadron divisionnaire, placés sous les ordres du
capitaine Billy du 15-2 ; la préparation d'artillerie déclencha une violente
réplique. Les soldats pénétrèrent dans quelques
lignes inoccupées avant de rejoindre leurs tranchées de départ,
bouleversées par le bombardement.
Dans le secteur Colardelle, le 334e fut relayé à la
mi-septembre par le 213e et engagé à
l'Hartmann. Durement éprouvé, le régiment
redescendit des hauteurs début novembre 1915
pour relever le 229e R.I. dans le secteur Simon.
Les troupes alternaient l'occupation du H.W.K.
et de ses satellites : la cote 425, l'Hartfelsen, le
Sûdel ; ces rotations devaient préserver l'initiative et le mouvement,
tout en capitalisant l'indispensable connaissance des lignes, des positions et des pièges de chaque secteur. Dans la
nuit du 30 au 31 octobre, le Ve bataillon du 334e
R.I remplaça le bataillon Sutter du 229e R.I. dans le sous-secteur de
l'Alsacienne ; la 17e Cie s'établit à 425, la 18e sur les pentes nord de la croupe et la 19e devant Steinbach ; en réserves, la 20e
Cie. prit position dans le village, à Pervenche et à la Chapelle tandis
qu'un peloton de la 4e Cie
du 57e R.I.T s'installa dans les abris sous roche
du Hirnelestein. Dans la nuit du 10 au 11 novembre le VIe bataillon prit la place du bataillon
Derriey dans le sous-secteur Bonnelet. Chaque
compagnie passait six jours en ligne et six jours
en réserve ; les 21e et 23e alternaient à Vieux-Thann et aux pentes sud de la cote 425 ; les 22e
et 24e se succédaient à Vieux-Moulin et entre la
route de Cernay à la Thùr. Le sous-secteur Sairon
était tenu par le IIIe bataillon du 57e R.I.T.
(Leleux).
Sur la cote 425, la fonte des neiges, les orages
d'été et les pluies d'automne, transformaient les tranchées en torrents
de boue. Plusieurs fois, soldats français et allemands durent sortir sur les
parapets avant de retourner dans leur bourbier ;
l'adjudant Paul Guyot du 334e R.I. décrivit les tourments que la nature
infligeait aux combattants de 425 : "La vie de misère que la boue de
425 et l'eau de la Thur firent au régiment, je
renonce à le dire. Ah ! elles ont perdus leur mine
hospitalière, les confortables, les coquettes tranchées du 229e. Les compagnies qui ne sont pas
dans l'eau sont dans la boue. La pluie dissout
l'argile ; filtré par le clayonnage, le parapet
coule au fond du boyau. Les parois s'évasent et
s 'affaissent en lis gluants où l'on glisse, où l'on
s'enlise. Jour et nuit, on vide les boyaux, on relève les effondrements : hélas ! sitôt rejetée au
bord du fossé, la boue liquide retombe au fond,
tant qu'on a pas trouvé dans le commerce assez
de seaux et d'écopes pour la transvaser au loin,
dans le bled. Les abris se changent en puits, et
sans égard pour les tentures de mousseline, leurs
parois s'éboulent. Que devenir ? ". Cette boue
glaiseuse qui tannait les peaux, ruisselait dans les
moindres recoins, enrayait les fusils, les gardiens
de 425 l'écumèrent tels des naufragés, inlassablement, avec l'énergie de la survie.
De la mi-décembre 1915 à la mi-janvier 1916, le
secteur fut touché par la tempête qui couvrait
l'Hartmann ; les artilleurs allemands pilonnèrent
les lignes arrière, mais l'attaque d'infanterie,
attendue, n'arriva pas. Le 140e R.I. s'installa,
découvrant ce bout d'Alsace qui, un an auparavant, avait fait la une des communiqués. Les
semaines et les mois s'égrainèrent, rythmés par
les tours de garde, les patrouilles, les ordres du
jour, les ravitaillements et les travaux de consolidation. Steinbach, casemate et entouré de chiens
d'alerte, était plutôt calme. Sur le plateau
d'Uffholtz, au matin et au soir tombant, les
mitrailleurs allemands tiraient quelques rafales,
comme s'ils voulaient signaler leur présence. Les unités,
essentiellement territoriales, se succédèrent : le 3e B.T.C.A (commandant Léonce de
Seynes) s'établit dans le secteur à partir de la fin
de l'été 1916 ; le 6e B.T.C.A., commandé par
Georges Desvallières "- le peintre qui renouvela
l'art religieux français après guerre, fit un court
séjour dans les tranchées de 425 ; sans oublier
les 2e et 7e B.T.C.A., le 84e R.I.T, au printemps
1918, le 109e R.I. et bien d'autres. Les nouveaux arrivants étaient
initiés aux singularités du secteur par le commandant Repiton-Préneuf, major
de tranchées, qui arpentait inlassablement les
lignes ; sa silhouette familière finit par se mêler
au paysage.
En octobre 1916 et février 1917 les groupes
francs du 245e R.I., commandés par les sous-lieutenants Maillard et Préjean entreprirent des
coups de main contre le saillant 425, préparés
par des mortiers de 58, les fameux crapouillots ;
Albert Préjean, le futur acteur révélé par René
Clair, nota dans son journal à propos de ces têtes
brûlés dont il était : "C'était des petites équipes
de gars gonflés qui s'en allaient faire des coups
de main dans les lignes ennemies. Aussi gonflé
que l'on ait, les nerfs qui craquent et les cheveux
qui se dressent sur la tête, ça existe croyez-moi !
Je préférais risquer ma peau à chaque coup de
main que de moisir dans la tranchée. Et puis, dans les corps francs, là
au moins on avait l'avantage d'avoir quelques jours de perm ' quand
nous avions réussi. Naturellement, entre toutes
ces permissions, je trouvais le temps de me faire
blesser une première fois, puis une seconde. Les
balles entraient dans la peau et choisissaient
toujours le gras des chairs. Je devais être béni
des dieux de la guerre : superstition, je ne sais
pas ".
Après l'armistice, fin novembre 1918, les habitants rescapés retrouvèrent leur village, méconnaissable. Ils s'installèrent dans des baraques en
bois fournis par l'Etat. Les enfants retournèrent
à l'école et une petite église provisoire fut installée dans le jardin de l'instituteur. Dans les
décombres, on retrouva la cloche, presque intacte, qui servait à sonner le glas des trépassés.
Installée sur des tréteaux, elle rythma à nouveau
la vie du village. La vie, bien que précaire, reprenait le dessus et la reconstruction des maisons se
poursuivit jusqu'en 1924, année où s'acheva l'édification d'une nouvelle mairie-école, sur les
fondations mêmes de l'ancienne. De 900 habitants en 1914, Steinbach n'en comptait plus que
360 en 1921. La cote 425 fût abandonnée au
maquis et aux herbes sauvages.
"Peu de terres furent replantées en vignes ; la
plus grande partie resta en friche, abritant en
son sein des casemates, des abris, du fil de fer
barbelé, des obus et aussi des cadavres. Sur cette
terre de maléfice, vouée à l'improductivité, une
végétation spontanée renaissait, s'étalait, envahissant tout le terroir. C'était des haies épineuses, de l'acacia, du cerisier sauvage... Le beau
vignoble égayé jadis par le chant des vigneronnes, devint une belle chasse au lapin de garenne
et au faisan..." (Frédéric Preiss). La cote 425, die
Höhe 425, le champ de bataille le plus méridional du massif vosgien,
redevenait une colline discrète. La boue rouge, le voile de la nature et du
temps, recouvraient les cadavres. Les combattants rescapés avaient
emporté avec eux le souvenir de 425 et de Steinbach en flamme.
__________
GUYOT (Paul), Histoire d'un Régiment, Maçon, Librairie L. Durand, 1926.
PELLISSIER (Robert Edouard), A Good Idea of Hell. Letters from a
Chasseur à Pied, Texas A&M
University Press, 2003 ; correspondance et carnets retranscrits par
Joshua Brown.
SERGENT (Jules), A l'Est, du nouveau, Lyon, Impr. Audin,1930.
RAVEL (Maurice-Paul), A la mémoire de mon fils, Ravel Maurice Paul,
rédacteur au ministère de la
guerre, lieutenant au 213e régiment d'infanterie (...). Carnet de route
en Alsace pendant la Grande-Guerre 1914-1918. Lettres et Mémoires, Draguignan, Impr. Negro, 1922.
NION (Bruno), « Albert Préjean, acteur de deux guerres », in Militaria
Magazine, n°196, novembre
2001.
Carnet de guerre d'Edouard Guillouard et photos Leglaive, publication
Internet www.odile-halbert.com
BAILLY (Albert), Le 15-2 pendant la Grande Guerre. De l'Alsace aux
Flandres, 1914-1918, Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1919.
BERTHELOT (Commandant), Le 152e régiment d'infanterie. Le régiment des
diables rouges de 14-18.
Le régiment des terroristes de 44-45. Le premier des régiments de
France, Paris, Impr. nationale, 1947.
BOUCHER (Paul), « Note sur la participation de la 1" Cie. du 152e R.I.
aux attaques de Steinbach »,
in Bulletin de liaison des Amis du Hartmannswillerkopf, n°19, 1988.
[COLLECTIF], Le Quinze-deux. De la 152e demi-brigade de bataille (1794)
au régiment des Diables
rouges (1918), Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1935.
ROSENBLATT (Bernard), Le 15-2, 152e régiment d'infanterie. Histoire des
diables rouges, Bischheim,
Impr. Sicop, 1994.
RÔSCH (Max), Das Wùrttembergische Landwehr-Inf-Regiment Nr. 119 im
Weltkrieg 1914-1918,
Stuttgart, Belser, 1923.n.) Nr. 25 im Weltkriege 1914-1918, Berlin, Verlag Tradition W.
Kolk, 1929.
HUTTMANN (Adolf), KRÛGER (Friedrich Wilhelm), Das Infanterie-Régiment
von Lützow
(1. Rhei
Historique du 5e bataillon alpin de chasseurs à pied, Nancy, Berger-Levrault,
1929.
Journal des marches et opérations de la 66e D.L, S.H.A.T, cote 26 N 387.
Journal des marches et opérations du 152e R.I.,S.H.A.T, cote 26 N 697.
Journal des marches et opérations du 213e R.I.,S.H.A.T, cote 26 N 716.