|
La
véritable bataille est un moment périssable, une tornade qui
surgit sur un bout de terrain et emporte tout. C'est une
rencontre tumultueuse, un espace d'expérimentation, de
construction et de déconstruction, qui met en scène des hommes,
du matériel, des sentiments. Elle fait l'objet de scénarii, de
rapports, de conjectures, mais sa nature vivante, à la fois
anthropique et irrationnelle, lui fait écrire sa propre
histoire, unique et insaisissable ; sa réalité échappe aux
règlements, au romantisme patriotique et au confort des travaux
historiques.
Une bataille est mille batailles, différentes, contradictoires,
personnelles, intérieures. Bien sûr, elle laisse des souvenirs,
des chroniques pour les plus grandes, mais peu de traces
visibles, manifestes. La guerre ramasse ses ruines et ses
cadavres, elle camoufle son œuvre ; les dépouilles, les objets
que le sol n'a pas enfuis sont glanés, les tranchées comblées,
les corps enterrés, les navires engloutis. Que reste-t-il de
Sadowa, de Bull Run ou du Jutland ? Pourtant, souvent, des
indices subsistent, des plaques, des monuments, des vestiges
tapis dans les sous-bois, des plis du paysage. C'est le cas de
la bataille de Steinbach, en Haute-Alsace ; ce petit village de
paysans-vignerons blotti à l'entrée du vallon du Silberthal que
la Grande Guerre transforma en champ de ruines, mais dont le nom
n'est pas resté gravé dans les mémoires à l'image des ses
semblables meusiens de Vaux, Douaumont ou Fleury ; des marques,
discrètes ou anodines par habitude, témoignent encore des
combats meurtriers et acharnés qui s'y sont déroulés, à la
charnière de 1914-1915, dans les rues, les vignes, sur les
coteaux environnants, la cote 425 au sud, le plateau d'UffhoItz
au nord : Dans le centre du village, sur la place des Diables
rouges, un monument aux morts, massif, taillé dans le granit,
marqué de lettres d'or et dont les plaques en bronze furent
coulées par un ancien du 152e, le sculpteur Victor Antoine ; des
noms de rues : de la cote 425, du 152e R.I. ; une croix de
guerre sous le blason au sapin et à la serpe.
Dans un verger en pente, une croix gravée : "Ici le 2 janvier
est tombé François Boucher - Sergent au 152e R.I. ; En souvenir
des braves soldats tombés à Steinbach ". Sur la cote 425, une
stèle de béton, impressionnante empreinte dressée par un
sculpteur suisse, Guido Nussbaum, après la découverte
d'ossements mis au jour par des bulldozers lors de travaux
d'extension du vignoble ; une pierre tombale, enchâssée dans un
muret, à la mémoire d'un jeune soldat allemand, Otto Bunge, tué
le 14 mars 1917.
Dans le Zurenthal, une petite pyramide de pierre érigée en 1915
à la mémoire des morts du 297e R.I.
Et puis, parfois, par un effondrement révélant une sape ou un
abri, le passé guerrier se rappelle aux villageois pris dans la
routine des existences.
Dans le sillage de la tornade
Dès le déclenchement des hostilités, le souffle des combats
effleura Steinbach, mais rien ne le prédestinait encore à son
terrible destin ; il n'était qu'un village d'Alsace parmi les
autres, avec ses auberges, ses fontaines, ses pavés, connu pour
ses mines de fer et d'argent, et son vignoble qui produisait un
vin fameux, le "Steinbacher Rota".
L'offensive du détachement d'armée Bonneau et l'entrée
triomphale des troupes françaises dans Mulhouse le 8 août 1914,
toucha par ricochet le paisible village de neuf-cents âmes. Dans
la marche en avant euphorique des pantalons rouges, sous un
soleil de plomb, le 133e R.I. atteignit Cemay (Sennheim), la
ville aux remparts, voisine toute proche, le 8 vers 17 heures.
Les 6e et 7e Cies furent placées en avant-postes à Uffholtz et
quelques patrouilles traversèrent Steinbach.
Le lendemain, des cavaliers allemands furent repérés sur les
hauteurs de Wattwiller ; un poste d'observation fut installé sur
la cote 375 au sud de Steinbach et deux batteries du 4e régiment
d'artillerie y prirent position ; vers 11 heures, à Cernay,
alors que la population sortait des offices du dimanche, un obus
de 77 éclata et des crépitements de mitrailleuses se firent
entendre vers Ufflholtz. Le XVe Armeekorps du Général der
Infanterie Berthold von Deimling se rapprochait : la 39e
Infanterie Division (Freiherr von Watter) était chargée de
reprendre Cernay puis Thann ; depuis les hauteurs sud-ouest de
Bertschwiller, l'artillerie allemande commença à bombarder
Uffholtz.
Le 133e se déploya en arc en avant de Cernay et des éléments du
1° bataillon furent envoyés à Steinbach ; à Cernay, le III°
bataillon occupait, au sud, la gare, et au nord la fabrique
Schwartz ; le reste du régiment (2e, 3e, 4e et 5e Cies.)
s'établit au nord-ouest de la ville en arrière du ravin de
Steinbach et sur la cote 425. On creusa à la hâte des tranchées
pour tireurs à genou. Vers 13 heures, la 61e Infanterie-Brigade
(von Frankenberg und Ludwigsdorf), composée des I.R. 126 et 132,
reçut l'ordre de s'emparer de Cernay, appuyée par la 82e Brigade
(I.R. 171 & 172). Les Allemands, avançant par bonds de
tirailleurs à travers les vignes et les champs, débordèrent
Uffholtz par le nord-ouest ; deux compagnies françaises,
assiégées dans Uffholtz, résistèrent près de deux heures.
Dans son carnet, à la date du 9 août, l'Unteroffizier Emile
Boeschlin ( I.R.172) nota:« Le matin à 3 heures nous avons
quitté la caserne à pied (située route de Wintzenheim à Colmar)
en direction de Cernay. C'était dimanche. Une chaleur terrible.
Nous passons devant l'asile d'aliénés de Rouffach. 22 heures
sans manger. Les médecins et les brancards étaient déjà prêts.
Pas le temps de manger. Le drapeau fut déployé et cela put
commencer. Après les premiers coups de feu, nous étions
maintenant sûrs qu' 'il y aurait la guerre. Nous avons pris
Uffholtz d'assaut, en direction de Cernay. Le feu et le chaos.
Cernay était bombardée par notre artillerie ".
Vers 15 heures, les troupes feldgrau atteignirent les faubourgs
nord de Cernay et pénétrèrent à l'ouest de la ville ; à l'est,
deux bataillons du I.R. 136, détachés de la 30e Division (von
Eben), assaillaient les Français. Le IIIe bataillon du 133e,
désormais attaqué de front et de flanc par un ennemi bien
supérieur en nombre, subissant à l'intérieur de la ville des
tirs de soldats habillés en civils, recula vers la fabrique Witz
et la cote 375.
Le Feldartillerie Régiment 66 prit position sur le plateau d'UffhoItz
; face aux 48 pièces allemandes, les Français replièrent leurs
deux batteries de 75 sur Vieux-Thann ; les tirs d'artillerie en
écharpe obligèrent le Ier bataillon du 133e à évacuer Steinbach
; les Allemands déployèrent leurs Maxims dans le village et sur
la crête allant vers Cernay. Vers 16 heures, les soldats
français refluèrent vers le sud, attendant en vain un soutien du
23e R.I. ; vers 19h30, menacé d'enveloppement et pris en
enfilade par les mitrailleuses allemandes, le 133e se replia sur
Vieux-Thann. Dans la foulée, le 15e B.C.P. contre-attaqua sur
Cernay depuis la ferme du Lutzelhof dans le Nonnenbruch ;
subissant de lourdes pertes, le bataillon dut se replier.
Deimling salua l'opiniâtreté de l'adversaire lors de ces
combats. Craignant une nouvelle tentative ennemie durant la
nuit, les Allemands ne stationnèrent pas dans l'enceinte de la
ville ; la calme revint durant quelques jours avant que le
va-et-vient des uniformes ne recommença.
Le général Pau, à la tête de l'Armée d'Alsace, reprit
l'offensive le 14 août, alors que l'essentiel des unités de la
7e Armée (Von Heeringen) quittait la région ; les XIVe et XVe
Armeekorps partaient renforcer, à gauche, l'offensive générale
de la 6e Armée du Prince Rupprecht de Bavière, en Lorraine. Les
Français avancèrent prudemment devant un adversaire qui se
dérobait ; ainsi le 16, ils atteignirent la ligne Cernay,
Schweighouse, Burnhaupt-le-Bas et le 18, au soir, une partie du
133e R.I. réoccupait Cernay ; les soldats cherchèrent les tombes
de leurs camarades enterrés dans le secteur.
Au même moment, un détachement mobile, rattaché au XIVe
Armeekorps et constitué le 13 août sous le commandement du
Général de l'Infanterie Hans Gaede, traversa le Rhin ; composé
de 29 bataillons, 3 escadrons et demi et 16 batteries, de
Landwehr et d'Ersatz badois, bavarois et wurtembergeois, il
était chargé d'appliquer le plan Schlieffen de couverture en
Haute-Alsace ; le détachement hétéroclite du général Gaede tint
en haleine les 115 000 hommes du général Pau.
Joffre pressentit le danger. Le 17 août, il demanda à Pau de se
mettre en relation avec le commandant de la 1° armée. Mais il
était trop tard !
Sur le front lorrain les Français étaient battus à Lagarde, à
Cirey, à Morhange et surtout à Sarrebourg le 20 août ; de
nombreux éléments des I° et II° armées battaient en retraite ;
le G.Q.G. prescrivit un arrêt des opérations offensives en
Alsace et l'envoi du 7e C.A. (sauf la 41e D.I.) vers le nord ;
au matin du 25 août, les troupes françaises évacuaient Mulhouse,
ainsi que presque toute la Haute-Alsace dans la nuit ; cette
retraite précipitée, les abandons successifs de Mulhouse (25
août) puis de Guebwiller (31 août), portèrent un coup sévère à
l'image des "libérateurs" ; la libération de Mulhouse ne fut
qu'un feu de paille, une bouffée frénétique dans un été de feu.
La presse et les communiqués parisiens se retrouvaient dans
l'attente d'une grande victoire sur le front d'Alsace ; elle se
fit attendre !
Le 7 septembre, la 55e Brigade de Landwehr du général Mathy (7e
Landwehr Division), forte de deux régiments, les L.I.R.40 et
119, reprit Cernay et Uffholtz sans grandes difficultés. Le 10,
le II° bataillon du L.I.R.40 attaqua Vieux-Thann et fut repoussé
par des éléments des 171e et 213e R.I.. Le même jour, la
18e Cie. du 213e R.I. effectua une reconnaissance sur l'AmseIkopf
et Steinbach ; la section Vessereau entra dans le village par la
lisière sud, y récupéra un caisson de munitions pour
mitrailleuse et un prisonnier, puis grimpa sur la cote 425 où
deux sections allemandes l'accueillirent. Du 11 au 13, la 116e
brigade (58e D.R.) repoussa une offensive allemande sur Thann,
lancée depuis le secteur de Steinbach ; le 25,le L.I.R. 119
tenta à nouveau d'enlever Vieux-Thann, sans succès.
Dès la fin octobre, Joffre décida de reprendre l'offensive sur
le front d'Alsace, le gouvernement souhaitant prendre des gages
dans les provinces abandonnées au Reich en 1871 par le traité de
Francfort. En novembre, à Thann - capitale provisoire de
l'Alsace française - le général en chef déclara : « Notre retour
est définitif, vous êtes Français pour toujours » ; l'Etat-major
espérait, grâce à un mouvement convergeant des 57e et 66e D.I,
avancer vers la plaine, menacer les mines de potasse qui
fournissaient un engrais essentiel à l'agriculture allemande et,
plus loin, la zone industrielle de Mulhouse ; l'offensive
générale prévue pour la mi-novembre, retardée, ajournée, se
traduisit finalement par des opérations plus locales, souvent
stériles, sur Michelbach, Burnhaupt, Aspach et Ammertzwiller qui
devaient selon la directive de Joffre du 26 novembre, sécuriser
les communications entre Thann et Belfort et interrompre par le
canon la circulation sur la voie ferrée Colmar- Mulhouse. Début
novembre le général Putz, commandant le 34e Corps, avait
envisagé une progression dans la vallée de la Lauch, et vers
Cernay, ce qui, selon lui « ne paraissait pas, pour le moment,
présenter de difficultés insurmontables » ; Cernay, le verrou du
bassin potassique, était dans ligne de mire de la 66e D.I. ;
Steinbach n'était qu'une bourgade sur le chemin des remparts
cernéens. Les villageois pensaient encore pouvoir courber le dos
en attendant que l'orage passe.
Devant Thann, les avant-postes français avaient été
successivement aménagés par les 133e, 285e et 213e R.I. ; ils se
situaient vers la Waldkapelle - la chapelle des bois - et à la
lisière est de Vieux-Thann. Désormais, dans les forêts
descendant de l'AmseIkopf à Vieux-Thann, des hommes vivaient,
travaillaient, disséminés en de petits campements parfois
difficiles à ravitailler. Le bois, abondant, assurait protection
et chaleur : il permettait de renforcer les parapets des
tranchées, d'édifier des remparts d'abatis, d'alimenter les
poêles, de construire toutes sortes de cabane et d'abris. Des
patrouilles poussaient vers le nord...
Le lieutenant Maurice-Paul Ravel de la 23e Cie du 213e R.I.
laissa un témoignage épistolaire considérable sur ce secteur du
front ; ainsi, aux premiers jours de décembre, il écrivit :
"L'automne a dépouillé les arbres de leur feuillage. Le bois,
jonché de feuilles mortes ou couvert de mousses flétries est
aujourd'hui clair et transparent et laisse apercevoir en bas, la
plaine grise, semée par endroits d'eaux dormantes (les
inondations de la Thur), qui luisent au soleil ou au clair de
lune. (...) Depuis que le rideau de verdure est tombé on
distingue mieux l'ennemi, on découvre les villages qu'il occupe
; on observe ses mouvements. La nuit on voit briller ses feux ;
on entend sa voix et parfois ses chants. (...) Nous ne jugeons
pas les boches assez entreprenants pour tenter une surprise de
nuit dans cette région difficile, semée d'embûches, à travers
ces bois immenses où il est presque impossible de s'orienter la
nuit " ; puis redescendu à Vieux-Thann, occupant une usine
abandonnée dont le grenier avait été transformé en observatoire,
Ravel pu contempler les travaux d'un ennemi devenu "maître dans
l'art de la fortification ". "Toute la journée et une partie de
la nuit, ils manœuvrent la pelle et la pioche et remuent des
monceaux de terre. Comme ils redoutent une offensive de notre
part, ils ont construit sur le front Steinbach-Cernay-Oberaspach,
un vaste système de tranchées reliées entre elles par un vaste
réseau de fils de fer qui barre complètement la plaine. La plus
remarquable de leurs tranchées, la plus facile à observer, est
celle qui est à cheval sur la route de Thann à Cernay. Elle a
deux cents mètres de long et comporte plusieurs abris pour
mitrailleuses. Les boches travaillent continuellement à cette
tranchée qu' 'ils façonnent comme une œuvre d'art. Toutes les
fois que j'en ai l'occasion, je l'observe longuement à la
jumelle. A la longue on finit par observer avec le même esprit
et la même tranquillité d'âme qu'un astronome examine la surface
des planètes. On voit les boches aller et venir, monter la
garde, se ravitailler, manger la soupe. En un mot on pénètre
toute la vie de la troupe qu' 'on a en face de soi ". Alors que
Ravel écrivait ces lignes, empreintes de sensibilité, le temps
des guetteurs s'achevait ; celui des grandes manœuvres débutait.
Le 8 décembre, le Détachement d'Armée des Vosges (41e, 57e, 66e,
71e D.L, 10° D.C.) fut constitué et le général Putz en prit le
commandement ; le même jour, il fit part de ses plans : "c 'est
par les crêtes descendant du massif de Guebwiller, qu' 'avec des
chasseurs, je chercherai à m'emparer d'Ufflholtz et à faire
tomber Cernay » ; « L'occupation d'Aspach-le-Haut et des bois à
l'est de Michelbach est un fait accompli depuis le 1er décembre,
et elle va être complétée très prochainement par celle de la
gare d'Aspach, qui coïncidera avec celle de l'éperon qui domine
Cernay au sud-ouest de Steinbach ". Cela semblait alors facile,
évident : un éperon sans nom, un point insignifiant sur la carte
d'Etat-major ; qui aurait pu imaginer que ce monticule se
transformerait en un gigantesque tombeau ?
La 66e D.I, "l'Alsacienne", commandée par le général Guerrier,
amorça son mouvement vers la plaine face à la Brigade Mathy ; la
gare d'Aspach-le-Haut fut prise le 10 décembre par le 242e R.I
et le détachement Pelacot du 213e R.I... Le lendemain, la 7e Cie
du L.I.R. 119, en reconnaissance dans le secteur de l'AmseIkopf
et du Hirnelestein, fut accrochée par les Français ; le 12, la
115e brigade du colonel Sicre (213e, 229e d'Autun, 334e R.I. de
Maçon) reçu en renfort le 5e bataillon de chasseurs, engagé dès
le lendemain pour enlever Steinbach et la cote 425 ; les
patrouilles allemandes signalèrent un renforcement des troupes
ennemies sur les hauteurs entre Wattwiller et Uffholtz.
Les premiers grains
Le dimanche 13 décembre 1914, au matin, les cloches de Steinbach
résonnèrent comme d'ordinaire ; à 12 heures, l'artillerie
française (42e batterie de 65 du 2e R.A.M.) ouvrit le feu sur
'l'éperon au sud-ouest de Steinbach " : la cote 425. Les
Allemands répliquèrent par des tirs de la batterie Boenig ; au
même moment, la 27e batterie de 75 du 37 R.A., en position au
crassier de Vieux Thann, tira sur des renforts allemands envoyés
d'Uffholtz vers Steinbach. L'attaque, confiée à des éléments
détachés des 213e R.I (lieutenant-colonel Frantz), 5e B.C.P. et
68e B.C.A. (du groupement alpin de la division), fut déclenchée
à 13 h. 30.
Le détachement du commandant Colardelle (deux compagnies du
5CB.C.P., une du 213e R.I. et une du 68e B.C.A.) avait pour
mission de prendre Steinbach puis, à revers, de soutenir
l'assaut du détachement Debain sur les tranchées de la cote 425.
Vers 14 heures, les 2e et 3e Cies. du 5e B.C.P., emmenées par le
capitaine Willigens, gagnèrent la croupe de la chapelle Saint
Antoine ( Saint Morand), au nord-est du village, puis
déferlèrent sur Steinbach ; le capitaine Chenot fut tué en
arrivant vers les premières maisons. Le poste de garde de la 5e
Cie. du L.I.R. 119, tenu par le Leutnant Fach, submergé, résista
plus d'une heure à 15h15, la position était prise avec 25
prisonniers.
Au sud, sous les ordres du commandant Debain du 213e, la 1er
Cie. du 5e B.C.P., la section de mitrailleuses et la compagnie
Jeambreau du 213e R.I assiégèrent durant quatre heures les
positions de la cote 425 tenues par le détachement du Leutnant
Schneider, de la 5e Cie. du L.I.R. 119. Vers 19 heures, malgré
l'arrivée de quelques renforts et alors que les Français
n'étaient plus qu'à une trentaine de mètres, le Leutnant
Schneider ordonna le repli sur l'usine de Sandozwiller et la
route de Steinbach, couvert par les tirs de la 4e Cie.. Les
Français retournèrent les tranchées prises et repoussèrent une
contre-attaque de deux sections de la 6e Cie. Dans le secteur de
la chapelle Saint-Antoine (saint Morand), sur le plateau d'Ufflholtz,
la Radfahrkompagnie et la 8e Cie. du L.I.R. 119, bousculées,
tenaient leurs lignes. Vers 23h, les 3e et 6e Cies. reçurent
l'ordre de reculer sur Uffholtz pour protéger le village durant
la nuit.
Une pluie torrentielle inonda les tranchées. Robert Pelissier du
5e B.C.P. laissa dans ses lettres et carnets une description
précise de cette première bataille de Steinbach. Né en 1882, il
avait quitté les Etats-Unis, sa patrie d'adoption, et
l'université Stanford où il enseignait la littérature pour
rejoindre les rangs des chasseurs à pied ; durant la guerre, il
écrivit régulièrement à sa famille à Brooklyn ainsi qu'à sa
fiancée à Auburn et à ses amis et collègues : "Nous entamâmes
donc notre descente sur des pistes en forêt, l'esprit traversé
de pensées. Le canon tonnait au-dessous de nous. Nous pouvions
apercevoir des ballons se balançant au-dessus de la plaine et un
« taube » qui ne cessait de décrire des cercles au-dessus de nos
têtes, nous obligeant à nous mettre de temps à autre à couvert.
Aux environs de 15 heures, nous sortîmes brusquement des bois
pour pénétrer dans quelque vignoble ; le village était là, à
près de 600 yards, dans une cuvette.
Dans l'intervalle, nous avions été repérés, et le tir débuta.
Nous nous dispersâmes en ligne sur la crête, ne laissant entre
chaque homme qu'un espace de deux mètres, et ce tout en tirant.
Puis nous nous levâmes tous, parcourûmes quelques mètres au pas
de course avant de nous allonger et de tirer à nouveau. Nous
avions progressé d'une bonne centaine de yards de cette manière
quand, à notre grande surprise, nous entendîmes nos clairons
sonner la charge. Nous étions encore à une bonne distance du
village, mais il n 'y avait rien d'autre à faire que se lever et
descendre dans les vignes en hurlant comme des sauvages. Au bas
de la pente se trouvait un ruisseau et nous nous dirigeâmes vers
celui-ci. Des hommes tombaient ça et là, d'aucuns s'éloignaient
en rampant. D'autres étaient immobiles. C'est à ce moment que
notre capitaine fut tué. Son ordonnance me raconta qu'il avait
été touché à l'estomac, était tombé d'un bloc, s'était assis,
avait rassemblé ses forces, avait ri puis avait perdu
connaissance. Il était mort peu après. Au moment où nous avions
atteint le ruisseau, nous y étions retranchés et avions ouvert
le feu sur des fenêtres et des toits nous paraissant suspects,
les Allemands s'étaient volatilisés ou s'étaient cachés dans les
caves. Le fait est qu' 'ils n 'avaient pas imaginé que nous
arriverions par la montagne, et ils furent pris tout à fait par
surprise. Nous nous sentions assez bien, parcourant le village à
la recherche de prisonniers, mais bien vite, c 'est nous qui
fûmes joués. Nous étions cinq compagnies, pas une de plus, et il
n 'y avait pas de possibilité d'obtenir des renforts qui
traverseraient cette satanée montagne. La pluie se mit à tomber,
et nous reçûmes l'ordre de creuser des tranchées aux abords du
village. Nous les creusâmes, mais toute la nuit nous entendîmes
également des trains ronflant dans la vallée en provenance de
Mulhouse et de Senheim. Leurs projecteurs ne cessèrent de zébrer
le ciel au-dessus de nous, nous amenant à nous aplatir dans la
boue à chacun de leur ratissage ".
La pression française sur Cernay devenant plus forte,
l'Etat-major allemand décida d'engager en renfort des éléments
de la division volante Fuchs (Generalleutnant Georg Fuchs),
constituée sur l'ordre du Kronprinz et forte de deux brigades
d'active, débarquées à la gare Mulhouse le 12 : la 31e
Infanterie Brigade (I.R. von Horn Nr. 29, I.R. 69), détachée de
la 16e Division, et la 29e Infanterie Brigade (Oberst von
Strantz), détachée de la 15e Infanterie Division sur le front
d'Ypres ; les deux régiments rhénans de cette Brigade Von
Strantz, le 25e Infanterie Régiment von Lûtzow et le 161e
Infanterie Régiment (Oberst Wilcke), devaient jouer un rôle
considérable dans les combats à venir autour de Steinbach.
Dans son journal, Auguste Zundel, adjoint de la ville de
Mulhouse, relata l'arrivée des jeunes soldats rhénans : "Grand
arrivage ; une division du 8" corps rhénan nous arrive de
Belgique ; environs 40 trains ; beaucoup déjeunes soldats,
parfois en piteux état ; ils viennent de Duixmuyden (Duimude)
et Ypers et racontent leurs aventures ; on leur a dit qu' 'ils
auraient une huitaine de jours de repos, et alors ils auront
l'honneur de l'attaque de Belfort". Ce repos fut écourté par
l'envoi sur Cernay.
Le 14 janvier, après une puissante préparation d'artillerie, la
Brigade von Strantz contre-attaqua, couverte sur la droite par
la 31e Brigade; le mauvais temps retarda l'opération, déclenchée
vers 11 heures ; les IIe et IIIe bataillons de l'I.R.161,
soutenus à gauche par les 3e et 6e Cies. et à droite par la 5e
Cie. du L.I.R. 119, attaquèrent Steinbach par un mouvement
enveloppant depuis la croupe Saint-Antoine. Vers 16 heures, la
8e Cie. du I.R.161 (Oberleutnant Meyer) était maître du village
; de nombreux soldats français furent fait prisonniers. Ils
avaient vainement attendu le soutien de la 22e Cie. du 334e R.I.
(capitaine Gossot), chargée d'assaillir le village par le nord,
mais qui avait du déloger un poste allemand installé au sommet
du Schletzenburg ; ce fut autour de ce promontoire que le
commandant Colardelle regroupa son détachement. Durant la nuit,
les soldats s'y retranchèrent, creusant le sol tels des ratiers,
brûlant leurs dernières forces.
Robert Pelissier souligna la vigueur de la contre-attaque
allemande sur Steinbach, l'épuisement de chasseurs acculés : "Au
petit matin, nous étions face à 16 compagnies allemandes et à
une forte artillerie. Nous étions trempés jusqu' 'aux os, n
'avions rien mangé et n 'avions pas dormi (le temps froid et
pluvieux, constante des combats de Steinbach, allait éprouver
bien des soldats par la suite). Néanmoins, il n 'y avait rien à
faire sinon se bagarrer et toute la matinée, heure après heure,
allongés dans un bois, nous tirâmes sur les Allemands, puis sur
d'autres Allemands encore, qui ne cessaient d'arriver alors que
l'artillerie déversait ses obus sur nous et que nous n'avions
rien à manger. Dans l'après-midi, nous dûmes reculer afin de ne
pas être encerclés.
Je pensai que nous retournions à notre point de départ, mais au
lieu de redescendre sur l'autre versant, nous tournâmes à droite
et à la tombée de la nuit, nous étions à nouveau au-dessus de
Steinbach. Nous passâmes une nuit de plus sous la pluie. Nous
mangeâmes quelques sardines et des biscuits. Nous apprîmes que
nous attaquerions le lendemain matin. Mais le lendemain matin,
il apparut que nous avions perdu trop d'hommes pour attaquer.
Dans l'après-midi, nous fûmes attaqués, mais nous nous en
tirâmes. Aux environs de 23 heures, notre commandant jugea qu'
'il était temps que nous nous retirions, alors nous nous mîmes
en marche en silence, un par un, et suivîmes de notre mieux un
sentier dans l'obscurité. Pour 6 heures, nous étions de retour,
en sûreté, dans la ville de Thann, mais nul n 'est besoin de
dire que nous étions tous éreintés. Nous n 'avions pratiquement
pas dormi ou mangé depuis trois jours, et nos vêtements avaient
parfois gelé sur nous. Nous avions perdu 525 hommes sur 1 400,
et cette affaire ne pouvait donc être qualifiée de succès. Tel
aurait été le cas si nous avions eu cinq compagnies pour nous
appuyer après que nous avions pris le village ".
Les défenseurs de la cote 425 avaient repoussé les assauts
allemands et seul un groupe d'une vingtaine d'hommes de la 4e
Cie. du L.I.R.119, entraîné par le Feldwebelleutnant
Schwerdtfeger, avait pu se maintenir en contrebas des positions
jusqu'au soir. L'Etat-major mobilisa alors cinq compagnies du
L.I.R. 119 (les 3e, 4e, 5e, 6e, et 8e) et une compagnie du
I.R.25 pour reprendre l'offensive ; dans l'obscurité, les
fantassins allemands gravirent les pentes boueuses et glissantes
du vignoble en traversant des clôtures ; un groupe d'une
trentaine d'hommes, sous les ordres du Leutnant Honold, prit
pied à mi-hauteur de 425, mais les tirs nourris de l'adversaire,
la nuit et la fatigue empêchèrent la poursuite du mouvement.
Dans les abris inondés, les Allemands entamèrent leurs rations
de Noël et, plus tard, les cuisines de campagnes arrivèrent vers
la fabrique Baudry. La 7e Cie., à Cernay, fut envoyée vers
Uffholz pour renforcer l'aile droite du régiment et colmater la
brèche avec l'I.R. 25.
Le retentissement des combats fût immédiat, mêlant comme souvent
rumeurs et réalités. Auguste Zundel consigna : "Grands combats
autour de Cernay ; les Français ont pris Steinbach le dimanche ;
les Allemands le reprennent lundi, non sans grosses pertes, ils
font 300 prisonniers, des chasseurs à pied, mais perdent plus de
2000 hommes. Le canon a tonné ces deux jours sans discontinuer.
La brigade du 21e a été décimée ; la Landwehr qui devait servir
les troupes actives faisant l'assaut a refusé de marcher, voyant
les premiers fauchés ; on ramène à Mulhouse des officiers les
mains liés ! Sans doute passerons-ils en conseil de guerre, mais
sont-ils responsables si leurs hommes refusent l'obéissance et
ne veulent se faire mitrailler ? Les survivants reviennent à
Mulhouse et sont relayés par l'autre brigade ; ils racontent que
la bataille a été plus meurtrière que celles auxquelles ils
avaient pris part en Belgique".
Le 15 décembre, vers midi, le commandant de Pelacot remplaça le
commandant Debain à la tête des troupes défendant la cote 425.
Côté allemand, le Generalleutnant Fuchs mobilisa des moyens
considérables pour s'emparer de l'éperon. L'I.R. 25 releva
l'I.R.161. et, vers 15 heures, l'artillerie bombarda violemment
les tranchées de la 5e Cie. du 5e B.C.P. (capitaine Délivre),
rapidement assaillis par le IIe bataillon du I.R. 25. Les
colonnes feldgrau percèrent les lignes et des combats rapprochés
firent rage autour du poste de commandement de la compagnie ;
englués dans la boue, des soldats urinèrent sur leurs armes
enrayées. Malgré le secours tardif de la 24e Cie. du 334e R.L,
les chasseurs durent se replier en contrebas de la croupe vers
le Hirnelestsein. La 20e Cie. du 213°R.I. (capitaine Bergeret)
reçut l'ordre de contre-attaquer sur 425, mais l'obscurité et
l'épuisement des hommes ajournèrent l'opération.
Sous une pluie diluvienne, les combattants creusèrent des
retranchements ; les hommes de Colardelle, harassés, ne pouvant
répondre aux ordres d'attaque sur Steinbach, furent ramenés sur
Thann vers 22 heures. Partout des bruits de pelles, de pioches
et de scies, des barbelés installés à la hâte. Toute la nuit,
dans Steinbach, sur le plateau d'Uffholtz et la cote 425, les
Allemands renforcèrent leurs positions ; l'Armee-Abteilung Gaede
tenait son premier grand succès et le Generalleutnant von
Falkenhayn, chef d'état-major général des armées en campagne,
transmis à Gaede les félicitations du Kaiser pour avoir défendu
le sol allemand. Les premières croix de fer de première classe (Eisernes
Kreuze 1.Klasse) furent distribuées à cette occasion.
Côté français, le choc était rude : en trois jours le 5e B.C.R,
à lui seul, avait perdu plus de 400 hommes. Une section du
groupe de brancardiers divisionnaires, le G.B.D. 66, arriva le
16, et fut répartie entre Pastetenplatz, Thomannsplatz et
Waldkapelle. Une partie de la population de Steinbach s'était
réfugiée dans les caves, une autre avait pris précipitamment la
fuite. Placé entre deux feux, victimes et spectateurs, les
villageois sortaient de leurs sombres cachettes lors des
accalmies pour ensevelir les cadavres, soigner les blessés et
chercher quelques vivres. L'usine Rollin, une fabrique de
caoutchouc située à l'ouest du village, ainsi que plusieurs
maisons étaient éventrées. Les Allemands, retranchés dans
les habitations, poursuivaient leurs travaux de fortification
tandis que les Français rassemblaient des troupes fraîches et de
l'artillerie. Des barricades, des traverses furent aménagées
dans les rues avec des cuves de vignerons et des tonneaux
remplis de gravats ; les nombreux grillages et barbelés déployés
couvrirent rapidement le village d'un filet d'acier.
Le 17 décembre, les soldats du I.R.25 furent relevés par les 3e,
5e et 7e Cies du L.I.R.119. Le régiment, désormais placé sous le
commandement de l'Oberst Scholl et renforcé par le
LandsturmbataillonMannheim, occupait Cernay et les hauteurs
entre Uffholtz et Steinbach. La 6e Cie tenait les tranchées de
425, quotidiennement harcelées par les Français.
Les déferlantes
Le 24 décembre, le général Putz ordonna à la 66e D.I. d'attaquer
« sur Wattwiller, Uffholtz, Cernay et la Croisière en débordant
Steinbach par le nord et par le sud » ; le général Guerrier
exigea aussitôt la poursuite des offensives sur le front
Wattwiller-Sandozwiller et l'ordre n°138 de la division pour le
25 décembre prescrivit la prise de Cernay. En sus du 213e R.L,
déjà bien rodé et dont les effectifs avaient chuté à deux mille
hommes, on engagea dans le secteur près de trois mille huit
cents combattants supplémentaires du 152e R.I. (Gérardmer) et du
15e B.C.P.(Remiremont) de la 81e brigade (colonel Mariano Goybet).
Le plan d'opération prévoyait, à gauche, une progression du 15e
B.C.P. vers Uffholtz et à droite, l'attaque de la cote 425 par
le Ve bataillon du 213e R.I (capitaine Larmes) en partant de la
Waldkapelle ; au centre, la moitié des troupes du 152e (six
compagnies ; quatre du II bataillon et deux du Ier) avait pour
mission de déboucher au nord de Steinbach par le Schletzenburg
puis d'avancer vers la lisière sud-ouest d'Uffholtz ; deux
compagnies du Ier bataillon (commandant Castella) devaient
descendre par l'AmseIkopf et le Hirnelestein puis, en liaison
avec le 213e, déborder Steinbach par le sud. Le groupe alpin du
28e B.C.A. était chargé d'appuyer et de couvrir sur la gauche le
mouvement de la brigade ; le IIIe bataillon du 15-2 serait
laissé en réserve de division au Thomannsplatz. Une section du
G.B.D. 66 arriva en renfort, présage funeste pour les soldats ;
en face, 5 bataillons allemands étaient en ligne. Le siège de
Steinbach allait commencer.
 Le
25 décembre, vers 1 heure du matin, le 152e R.I quitta son
cantonnement à Fellering. Le capitaine Lallemant de Liocourt,
commandant la 10e Cie. du IIIe bataillon décrivit dans son
journal de route sa veillée de Noël : "Vers minuit, suis
réveillé. Ordre de départ. Je dis adieu à la bonne petite
chambre et au confort. Marche dans la nuit, dans la vallée et
dans le silence. On traverse Wesserling, etc....On voit des
gens, des femmes, des sœurs qui vont à la messe de minuit, ou en
sortent. On se dit : ils en ont de la chance ceux-là....Les
autos de l'Etat-major nous rasent tout le temps. Voilà d'autres
heureux du monde. Grimpés de Bitschwiller à Pasteten, au petit
jour. Des civils aménagent le chemin. Pièces de 155 long. A
Pasteten : nombreux Alpins. On continue à marcher en colonnes.
Arrivée à Thomannsplatz. Petit Col ; pentes assez raides partout
; par-dessus, de gros blocs de pierre; par-dessus de la neige.
Voilà notre logis. Plus loin une hutte, c'est le poste d'alpins.
Il passe beaucoup de mulets et on gèle. On mange debout quelque
chose de froid et on se dit que c'est Noël. Passage du 15
Chasseurs, qui est encore flambant neuf". Vers 6 heures, le
commandant Jacquemot, siffla une pause et du café fut préparé.
Les fantassins en ordre de marche descendirent les crêtes ; des
nuées colorées et fiévreuses traversaient les forêts recouvertes
de givre ; la marche dissimulait les tremblements. Le
25 décembre, vers 1 heure du matin, le 152e R.I quitta son
cantonnement à Fellering. Le capitaine Lallemant de Liocourt,
commandant la 10e Cie. du IIIe bataillon décrivit dans son
journal de route sa veillée de Noël : "Vers minuit, suis
réveillé. Ordre de départ. Je dis adieu à la bonne petite
chambre et au confort. Marche dans la nuit, dans la vallée et
dans le silence. On traverse Wesserling, etc....On voit des
gens, des femmes, des sœurs qui vont à la messe de minuit, ou en
sortent. On se dit : ils en ont de la chance ceux-là....Les
autos de l'Etat-major nous rasent tout le temps. Voilà d'autres
heureux du monde. Grimpés de Bitschwiller à Pasteten, au petit
jour. Des civils aménagent le chemin. Pièces de 155 long. A
Pasteten : nombreux Alpins. On continue à marcher en colonnes.
Arrivée à Thomannsplatz. Petit Col ; pentes assez raides partout
; par-dessus, de gros blocs de pierre; par-dessus de la neige.
Voilà notre logis. Plus loin une hutte, c'est le poste d'alpins.
Il passe beaucoup de mulets et on gèle. On mange debout quelque
chose de froid et on se dit que c'est Noël. Passage du 15
Chasseurs, qui est encore flambant neuf". Vers 6 heures, le
commandant Jacquemot, siffla une pause et du café fut préparé.
Les fantassins en ordre de marche descendirent les crêtes ; des
nuées colorées et fiévreuses traversaient les forêts recouvertes
de givre ; la marche dissimulait les tremblements.
Dans les postes de secours disséminés le long du front, à la
Waldkapelle et entre Pastetenplatz et Schletzenburg (15-2), dans
le bois d'UffhoItz et au Thomannsplatz (15e B.C.E), à la Maison
Rouge (213e R.I.) on prépara morphine, pansements et boissons
chaudes. Le IIe bataillon du 15-2, 7e Cie. en tête et 4e section
en pointe d'avant garde, chercha le contact et s'établit au
Schletzenburg à 13h., au moment où l'attaque générale était
lancée. Débouchant de la lisière des bois les soldats, aussitôt
repérés, furent accueillis par des tirs de mitrailleuse partant
du clocher de Steinbach ; vers 16h, les compagnies se
retrouvaient, à gauche, appuyées au ravin d'UffhoItz ; à droite,
sur le saillant nord - nord-ouest de Steinbach à environs 700
mètres du détachement Castella qui dès sa sortie des sapinières
du Hirnelestein, avait été cloué sur place par les mitrailleuses
de la cote 425 ; depuis les hauteurs, de Liocourt observait le
théâtre des opérations : "C'est comme un tableau de bataille ;
on voit les nuages blancs des shrapnells des deux artilleries et
les lueurs des coups de départ allemands. Un coup massif de la
gare de Cernay, puis un coup de la forêt de Nonnenbruch, puis un
derrière la route. Nous allons aussi à l'Oetsenheim [le rocher
d'Ostein], d'où on voit le ballon de Guebwiller. Les Alpins
m'offrent une place pour la nuit. On apprend que l'attaque ne va
pas toute seule. Arrivée de blessés et de prisonniers ".
Le 15e B.C.P. était parvenu aux portes d'UffhoItz, occupant la
croupe au nord de la chapelle Saint-Antoine. En liaison par
patrouilles avec le 152e R.I., il put se maintenir sur ses
positions durant quatre jours. Les 16e et 17e Cies. du 213e R.I.
s'étaient élancées à découvert puis frayées tant bien que mal un
passage à travers les abattis qui protégeaient la tranchée
allemande de la cote 425 ; des tirs d'enfilade, partant de la
lisière sud-ouest du village, avaient contraint les fantassins à
s'abriter derrière les amoncellements de bois. L'appui des
canons de 65 de montagne, installés au Herrenfluh, s'était
révélé insuffisant ; à la nuit tombante, les soldats se
retranchèrent, réoccupant d'anciennes tranchées creusées par le
5e B.C.P.. La progression vers Uffholtz et Cernay, "l'affaire de
quelques heures", s'avéra bien plus difficile que prévue.
Dans la nuit du 25 au 26, les Allemands engagèrent en renfort, à
Steinbach et sur la cote 425, les 3e et 4e Cies. du L.I.R.40. Le
26, les efforts français se concentrèrent sur 425. Aussi, la 9e
Cie du 68e B.C.A., en repos à Bitschwiller, monta en ligne et le
groupe Castella fut provisoirement placé sous les ordres
lieutenant-colonel Frantz. Après une préparation d'artillerie
plus importante, le Ve bataillon du 213e R.I. et les sections
Castella s'élancèrent, à environ deux cents mètres des lignes
allemandes ; les 17e et 19e Cies. attaquèrent de front tandis
que la 21e Cie., au nord, et la 20e, au sud, essayèrent de
prendre la première ligne allemande en enfilade. La 6e Cie. du
L.I.R.119, ébranlée par le bombardement, ne céda pourtant que
peu de terrain ; l'Hauptmann Stübler demanda des renforts sur le
côté gauche. Les fantassins français refluèrent, subissant les
tirs d'enfilade de mitrailleuses installées dans les maisons en
lisière du village ainsi qu'une contre-attaque sur le flanc
droit. Le 213e R.I. perdit 151 hommes lors de cette journée. Les
blessés rejoignaient l'hôpital de Thann où l'ambulance alpine
1/74 tentait de faire au mieux sous les ordres du médecin
divisionnaire Uffholtz. Côté allemand, sur les 160 hommes de la
6e Cie., il n'en restait que 91. Vers 2h30, l'unité fut relevée
par deux compagnies du I.R.161 et redescendit sur Cernay. La
nuit fut froide et dans leurs trous hâtivement creusés, les
rescapés de l'assaut, s'emmitouflèrent dans leurs capotes et
leurs toiles de tente tandis que des tirs continuaient à
résonner ; l'artillerie française bombardait tout le secteur. Le
ciel se lézardait d'éclairs de lumière. Il devenait évident que
425 ne pouvait être enlevée sans une mainmise sur Steinbach.
Les Allemands mobilisèrent la 42e Kavallerie Brigade (Heidhorn)
; le Ile Ulanen Régiment prit position à Wattwiller et
Bertschwiller le 27, à l'aube ; le 15e Ulanen arriva le 29 au
soir. Le 27, le 15-2 reçut l'ordre de prendre pied dans
Steinbach tout en maintenant ses lignes sur le plateau d'UffhoItz.
Le groupe Castella devait progresser le long de la croupe entre
le village et la cote 425. Les 21e et 22e Cies du 213e devaient
monter une troisième fois à l'assaut de 425. Celui-ci fut lancé
à 9 heures, mais les réseaux de barbelés protégeant la tranchée
de la cote 425 et les tirs nourris venant du village eurent
raison des vagues de fantassins français. On creusa des
tranchées dans les vignes et en direction du village. Les
Allemands ripostèrent à ces préparatifs par un violent
bombardement de canons de 105 et 150 qui coûta la vie aux
capitaines Spiess et Vincens. Les Français réussirent à avancer,
à environ 200 mètres du village, une pièce de 65 qui tira sur
les premières maisons. La 4e Cie. du capitane Laroche investit
rapidement la villa Baudry (ancienne villa Brigitta), calcinée,
puis força l'entrée du village avec les 1er et 3e sections,
commandées par le lieutenant David et l'adjudant Jacques ; les
soldats se heurtèrent aux profonds réseaux de barbelés,
grillages, abattis et tirs des mitrailleuses, à un ennemi
embusqué dans les maisons, les caves, sous les toits. La
1°section fut arrêtée par un réseau de barbelés particulièrement
dense à une cinquantaine de mètres des habitations ; le
lieutenant Félicien David tomba. La 3e section, suivie par la
section du génie (aspirant Sportès), progressa par bonds jusqu'à
une trentaine de mètres du but.
L'adjudant Jacques fut tué en tentant de franchir un grillage
vertical qui barrait le passage ; quelques hommes y parvinrent,
rapidement encerclés ; un seul en réchappa, le soldat Bourgeois.
Sous un feu violent, les Français s'organisèrent défensivement ;
vers midi, la 2e section, puis la 4e, entrèrent en ligne pour
soutenir le mouvement de la 2e Cie. et se relier à elle. Toute
l'après-midi, la 4e Cie. se maintint à 30-40 mètres de la
lisière du village, au prix de lourdes pertes ; à la nuit
tombée, suivant les ordres de la brigade, elle se replia
discrètement, homme par homme. En trois jours, le régiment avait
perdu 183 hommes, tués, blessés ou disparus. Face à l'afflux de
blessés, l'Etat-major dut renforcer les services médicaux de
l'hôpital de Thann et du G.B.D.66 en mobilisant l'ambulance
alpine 1/64. L'ambulance 2/58, appelé en urgence, s'installa
dans l'hôpital Jungck à Moosch. A la fatigue des combats se
rajoutaient les épreuves de l'hiver ; le capitaine Lallemant de
Liocourt nota : "On a très froid, il neige. On voit toute les
lumières de Mulhouse et de Bollwiller. Nous faisons des huttes
de branches, mais le vent les traverse. (...) La nuit nous
faisons un peu de feu, mais même en nous plaçant juste devant,
nous n 'arrivons pas à dormir. Il fait trop froid par en
dessous" ; côté allemand, sur la cote 425, à Steinbach, Cernay
et Sandozwiller, les compagnies de l'I.R.161 relevèrent celles
du L.I.R. 119.
Le 28 décembre, une nappe de brouillard recouvrit le champ de
bataille. Dans l'après-midi, une compagnie du 15-2, soutenue par
la section
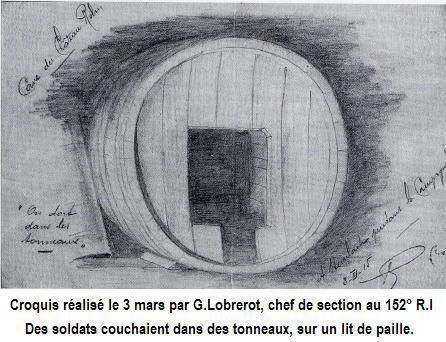 Vérine
de la 4e batterie, s'empara complètement du parc de la Villa
Baudry. La 8e Cie du L.I.R.119 fut envoyée soutenir la compagnie
du I.R. 161 qui occupait le village. Elle arriva vers 17 h. et
resta en réserve durant près de huit heures avant de rejoindre
les tranchées du plateau d'Uffholtz. Une attaque de 425 par la
23e Cie du 213e R.I. fut annulée par le pressentiment d'un
nouveau revers. Maurice Ravel brossa un tableau de la situation
à son père dans une lettre datée du 29 : "La bataille se
poursuit toujours sans résultat. La tranchée allemande de la
cote 425 tient encore et Steinbach n 'est pas encore pris. Je
crois qu'il faut renoncer à enlever la tranchée aussi longtemps
que le village ne sera pas à nous. Jusqu'à présent, toutes les
troupes qui se sont avancées vers la tranchée ont été prises de
flanc et décimées par des mitrailleuses ennemies installées dans
les maisons du village. Il faut donc soit s'emparer du village
soit le détruire. Les troupes du 152e d'Infanterie, chargées de
l'attaque, sont arrêtées depuis quatre jours à 300 mètres de la
lisière et ne peuvent avancer pour l'instant. Elles ont été très
éprouvées par la fusillade et plus encore par le tir des
obusiers allemands. Notre artillerie bombarde le village avec
fureur. Il brûle en plusieurs endroits. Le clocher a été éventré
et c 'est fort heureux, car l'ennemi ne peut plus s'en servir
pour observer et pour y installer des mitrailleuses.
Malheureusement, les effets du bombardement sont très localisés
et les obus ne délogent par les boches de leurs tranchées et de
leurs abris et surtout sont impuissants à détruire les réseaux
de fil de fer et les abatis. Hier, ma compagnie devait se porter
à l'attaque de la tranchée. Au dernier moment, on s'est rendu
compte qu'on irait à un échec certain puisque toutes les autres
compagnies avaient échoué dans les mêmes conditions. On va
essayer au préalable de détruire toutes les maisons où l'on
croit qu'il y a des tirailleurs et les tranchées d'où les boches
nous canardent". Vérine
de la 4e batterie, s'empara complètement du parc de la Villa
Baudry. La 8e Cie du L.I.R.119 fut envoyée soutenir la compagnie
du I.R. 161 qui occupait le village. Elle arriva vers 17 h. et
resta en réserve durant près de huit heures avant de rejoindre
les tranchées du plateau d'Uffholtz. Une attaque de 425 par la
23e Cie du 213e R.I. fut annulée par le pressentiment d'un
nouveau revers. Maurice Ravel brossa un tableau de la situation
à son père dans une lettre datée du 29 : "La bataille se
poursuit toujours sans résultat. La tranchée allemande de la
cote 425 tient encore et Steinbach n 'est pas encore pris. Je
crois qu'il faut renoncer à enlever la tranchée aussi longtemps
que le village ne sera pas à nous. Jusqu'à présent, toutes les
troupes qui se sont avancées vers la tranchée ont été prises de
flanc et décimées par des mitrailleuses ennemies installées dans
les maisons du village. Il faut donc soit s'emparer du village
soit le détruire. Les troupes du 152e d'Infanterie, chargées de
l'attaque, sont arrêtées depuis quatre jours à 300 mètres de la
lisière et ne peuvent avancer pour l'instant. Elles ont été très
éprouvées par la fusillade et plus encore par le tir des
obusiers allemands. Notre artillerie bombarde le village avec
fureur. Il brûle en plusieurs endroits. Le clocher a été éventré
et c 'est fort heureux, car l'ennemi ne peut plus s'en servir
pour observer et pour y installer des mitrailleuses.
Malheureusement, les effets du bombardement sont très localisés
et les obus ne délogent par les boches de leurs tranchées et de
leurs abris et surtout sont impuissants à détruire les réseaux
de fil de fer et les abatis. Hier, ma compagnie devait se porter
à l'attaque de la tranchée. Au dernier moment, on s'est rendu
compte qu'on irait à un échec certain puisque toutes les autres
compagnies avaient échoué dans les mêmes conditions. On va
essayer au préalable de détruire toutes les maisons où l'on
croit qu'il y a des tirailleurs et les tranchées d'où les boches
nous canardent".
A Mulhouse, Emile Zundel, sensible au sort des civils réfugiés,
nota : "Malgré une pluie battante, la bataille continue,
nombreux blessés sont amenés en ville puis promptement évacués ;
dans la nuit la tempête fait rage, mais ne couvre pas la
canonnade ; Steinbach et Cernay sont en feu ; on fait évacuer
les habitants sur Mulhouse et Ensisheim, plusieurs ont trouvé la
mort, beaucoup sont blessés. Officiellement l'attaque française
aurait-été repoussée, mais le contraire avait eu lieu, et
l'attaque en vue de reprendre les positions des hauteurs aux
environs de Steinbach et Thann par les Allemands a échoué avec
de grandes pertes. Les fuyards de Cernay arrivent et sont logés
par la ville au Pfundhaus et à la Herberge ; beaucoup se logent
chez des parents et amis". Quelques jours plus tard, il précisa
: "Ces malheureux sont obligés de quitter leurs maisons et leurs
biens ; ils ne peuvent emporter que le strict nécessaire, et
encore, dans l'affolement, ils oublient l'essentiel pour
emporter du superflu. A peine leurs maisons vidées , elles sont
occupées par la troupe qui s'y sent à l'aise, pille et saccage !
Une pauvre femme de Steinbach, perdant la tête, appelle ses
enfants égarés, on lui répond que ceux-ci sont sans doute morts
dans l'incendie ".
Le 29 décembre, sous une pluie glaciale, le 15-2 gagna du
terrain au sud et au nord du village, malgré les salves
provenant de "l'ouvrage en V", une tranchée-abri aménagée entre
l'église et la cote 425, et de la grande tranchée du plateau d'UffhoItz.
Les 5e et 8e Cies. du L.I.R.119, sur le plateau, déplorèrent des
pertes sévères dues à l'artillerie et aux mitrailleuses
françaises. Une contre-attaque allemande, attendue, ne vint pas.
La boue, collante et rubescente, envahissait tout; on pataugeait
dans des flaques fangeuses. Le 30 décembre, vers midi,
l'artillerie française, installée au Wolfskopf, au Pastetenplatz
et sur les hauteurs de Leimbach déclencha un bombardement dont
l'intensité crût au fil des heures. La 7e Cie. du 15-2 conduite
par le capitaine Marchand, réussit à prendre pied dans les
premières maisons de Steinbach, faisant 20 prisonniers, mais se
retrouva bloquée dans la grand'rue par une énorme barricade et
un incendie. Parmi les morts du jour, on compta le sergent
Boutroux, le neveu du philosophe Emile Boutroux, et le caporal
Baudry, un jeune chartiste. Sur le plateau d'UffhoItz, les 7e,
8e et 9e Cies. du 68e B.C.A. vinrent occuper les tranchées de la
croupe Saint-Antoine. Une nouvelle tentative sur 425, menée par
les 18e et 23e Cies. du 213e R.I. échoua. Maurice Ravel, nota :
"Ma compagnie (la 23e) a été chargée de la prendre d'assaut en
la tournant à gauche. Nous avons échoué, malgré l'artillerie qui
nous a soutenus jusqu'au bout, tandis que nous subissions un
bombardement terrible de la part des Allemands, bombardement qui
nous a cloué sur place. Cette affaire nous a coûté trois morts
et sept blessés. Le lieutenant, mon collègue, a été tué ". Mais,
inexorablement, les lignes françaises se rapprochaient des
positions allemandes ; le ravitaillement devenait difficile ;
les tirs d'artillerie provoquaient des incendies un peu partout
; la nuit, le village rougeoyait, parcouru par des ombres
furtives.
À l'aube du 31 décembre, Steinbach était pour près d'un huitième
aux mains des pantalons rouges. Les Allemands décidèrent
d'évacuer sur Cernay les civils encore terrés dans leurs caves ;
ils s'engagèrent sur les routes de l'exode, disséminés dans la
région de Mulhouse et le duché de Bade. La vie de réfugié,
incertaine et précaire, valait mieux que la mort ! Les combats
de rue, acharnés et meurtriers, se poursuivaient au milieu des
flammes, des bombardements incessants ; les tirs dérobés partant
des soupiraux, des toits, des murs crénelés fauchaient de
nombreux combattants. La progression se faisait maison par
maison, entre ruines, barricades et tranchées creusées à la
hâte. Au soir, les Français tenaient un tiers du village. Les
effectifs étaient sérieusement entamés ; aux morts et blessés se
rajoutaient les nombreuses évacuations pour gelures des pieds ;
les brodequins cloutés n'offraient guère plus de protection
après de longues heures dans une eau glaciale. La défense
allemande fléchissait, mais ne rompait pas ; une deuxième ligne
défensive avait été reformée à l'intérieur du village ; les
canonniers français et allemands tirèrent pour annoncer la
nouvelle année et la matinée du 1er janvier fut plutôt calme ;
courte trêve ; vers 14h30, deux batteries de 65 du 2e R.A..M et
une batterie de 75 du 56e R.A. engagèrent la préparation
d'artillerie sur Steinbach et la cote 425 ; la réplique
allemande, immédiate, se traduisit par une pluie d'obus de 105 ;
dans le village, les fantassins du 15-2, tenus en échec, ne se
rapprochèrent que d'une cinquantaine de mètres de l'ouvrage en
V, flanqué par les mitrailleuses de 425 ; deux avions aux
cocardes "bleue-blanc-rouge" survolèrent le secteur, offrant aux
Allemands l'occasion de tester leurs nouveaux obusiers arrivés
de Bavière (Langrohrhaubitzen).
Dans la nuit du 1er au 2 janvier, les éléments du 68 B.C.A.
repoussèrent trois tentatives contre les positions de la croupe
Saint-Antoine sur le plateau d'Uffholtz. Durant la journée du 2
et la nuit du 2 au 3, les Français grappillèrent encore un peu
de terrain ; les lignes les plus avancées s'établirent de la
chapelle Saint Antoine jusqu'à une centaine de mètres au nord de
l'ouvrage en V en passant par la place de la fontaine ; le
sergent François Boucher fut tué lors de cette progression (son
frère, Paul, qui commanda la 1" Cie. du 15-2 à l'Hartmann fit
ériger une croix en sa mémoire). La place de l'Église n'était
plus qu'à 150 mètres, mais les soldats rhénans de l'I.R.161
faisaient payer chèrement chaque mètre gagné ; ils résistaient
tels des forcenés, animés par le sursaut des bêtes acculées.
Sur le plateau d'Uffholtz, des silhouettes nouvelles étaient
apparues ; en effet, le 2 au soir, les II° et III° bataillons du
L.I.R.110 avaient relevé le L.I.R. 119, envoyé en repos à
Niedermorschwihr. Le froid, l'effroi, la boue jusqu'aux genoux,
les cendres fumantes, les combats nocturnes, les odeurs acres de
cadavres, entamaient les esprits les plus trempés ; fumées et
vapeurs se mêlaient au gris du ciel ; une atmosphère putride et
lunaire enveloppait le village ; la nuit, les vêtements mouillés
gelaient ; l'Etat-major français décida d'en finir !
|
![]()
![]()